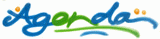Blada.com
Il est 10:56 en Guyane
vendredi 18 avril
vendredi 18 avril
le marron - chroniques atypiques de la guyane française
Chroniques
- Année 2021 (1)
- Année 2020 (2)
- Année 2019 (4)
- Année 2017 (1)
- Année 2014 (4)
- Année 2013 (9)
- Année 2012 (4)
- Année 2011 (6)
- Année 2010 (10)
- Année 2009 (12)
- Année 2008 (18)
- Année 2007 (12)
- Année 2006 (24)
- Année 2005 (18)
- Année 2004 (13)
- Année 2003 (6)
- Année 2002 (4)
- Année 2001 (6)
- Année 2000 (3)

par René Ladouceur
Méfions-nous des manuels, des statues, des lycées et des boulevards. Les grands hommes s’y affadissent. Ainsi de Félix Eboué.
Voilà un itinéraire parcouru, de la colonisation à la Seconde Guerre Mondiale, par toutes les passions de son temps ; un homme impliqué dans la victoire des alliés ; un Gouverneur général qui va freiner la progression allemande en Afrique ; un Guyanais qui va changer le cours du conflit en coupant à l’ennemi la route du pétrole ; un Cayennais qui va inspirer la politique africaine du Général de Gaulle ; un passionné d’ethnologie et d’anthropologie qui va mettre à mal les thèses alors en vigueur dans ces deux disciplines. Et voici que la mémoire collective le réduit aujourd’hui à quelques silhouettes caricaturales : le premier gouverneur noir ; l’administrateur colonial petit-fils d’esclave ; le franc-maçon qui rallie la France Libre du général de Gaulle ; le Compagnon de la Libération ; le membre du Conseil de Défense de l’Empire ; l’auteur de Jouer le jeu. La complexité de Félix Eboué se dissout même sur la place des Palmistes où sa statue, érigée il y a plus de 60 ans, arbore la triste expression de la photo jaunie d’un fils qu’une guerre n’a pas rendu.
Donc on est heureux chaque fois qu’un regard neuf, affranchi des répétitions paresseuses, nous donne à penser qu’il va restituer la richesse de ce tempérament et de cette trace. Au surplus, l’heure est favorable. Le 10 juin, la Guyane, pays natal de Félix Eboué, va commémorer à son tour l’abolition de l’esclavage. Et en cette année 2009, moult cérémonies rendent hommage à la fois au 60ème anniversaire de l’entrée de ses cendres au Panthéon et au 65ème anniversaire de sa mort. Cet opportun et salutaire hommage n’aurait certainement pas été possible en Guyane sans le Cercle Félix Eboué1, créé le 26 avril 2008. On peut compter sur son président, Yvan Chérica, pour qu’un des sociétaires du Cercle nous livre un jour non une biographie hagiographique mais l’analyse détaillée des débats historiographiques que suscite la vie de Félix Eboué.
En attendant, je me suis, pour ma part, royalement replongé dans Félix Eboué : Grand commis et loyal serviteur, cette biographie de René Maran que j’avais déjà annotée à presque chaque page, un peu comme ce dernier avait fait lui-même sur un manuscrit, au titre illisible, qu’il avait donné à lire à Eboué. Pendant la lecture de ce manuscrit, Eboué, il est vrai, n’avait cessé de dialoguer avec Maran sur un sujet qui lui était cher et qui d’ailleurs les obsédait tous les deux : le centralisme républicain et sa façon de préserver ce que l’on peut appeler en Guyane aujourd’hui l’identité régionale. Qu’est-ce qu’un Guyanais ? Quelqu’un qui l’est ou quelqu’un qui veut l’être ? Est-ce l’enracinement dans un passé régional ou le vouloir-vivre ensemble de chaque individu ?
A dire vrai, c’est parce qu’il n’aspirait à n’être point remarqué que Félix Eboué détonnait vraiment. Ce n’était pas tant qu’il fût noir, plus âgé que nombre de ses camarades de classe, plus consciencieux aussi, et presque trop souriant, c’est qu’il semblait venir d’un autre monde et ne faire que passer.
Dans cette Ecole coloniale du début des années 1900, on forme encore l’élite des administrateurs de la France d’Outre-Mer. L’établissement sent le vieux bois ciré. On y enseigne l’épistémologie, l’esthétique, l’arithmétique, l’histoire de la France éternelle, l’histoire de l’Empire. En classe, Félix Eboué seul met une rigueur de bénédictin à remplir de grands cahiers, à ne rien perdre de ce qu’on lui enseigne. Il ne prend pas de notes, il s’en gargarise. C’est probablement là que, mieux que les autres, il a conceptualisé l’altérité, la différence, la comparaison, l’accouchement du Moi par l’Autre.
Car on peut comprendre l’autre. Cette vérité première, Félix Eboué s’appliquera à l’expliquer à ses collègues, médusés, à Madagascar puis en Oubangui-Chari, ses deux premières affectations. On peut découvrir chez l’autre, précise-t-il aux fonctionnaires coloniaux, un ensemble de faits psychiques échappant à la conscience non éloigné du vôtre. La pensée sauvage n’est pas la pensée des sauvages, mais une pensée non encore domestiquée. De ce point de vue, l’ethnie, l’ethnicité ou l’ethnisme lui apparaîtront vite comme des catégories par trop réductrices. Dans un courrier adressé, à Paris, à un ami siégeant au bureau de la Ligue des Droits de l’Homme et du Citoyen, il écrit qu’enfermer les Africains dans un carcan ethnique est le pire service qu’on peut leur rendre. Les ethnies ne sont pas des essences, mais des processus. A Gaston Monnerville qui, à la tête d’une mission parlementaire d’enquête, lui rend visite au Tchad, il fait lire volontiers son Journal dans lequel il applique la formule de Renan sur les nations aux ethnies : « Les nations naissent et meurent ». Il en est de même pour les ethnies. Les derniers gardiens du temple ethnique sont les ethnologues et… les collectionneurs d’art africain. On l’a compris, la religion de Félix Eboué est faite. C’est à travers essentiellement le témoignage des Africains qu’il va lire la vraie histoire de l’Afrique et donc s’affranchir du réductionnisme ethnographique. Lorsque, en 1918, il fait publier une étude sur les langues Sango, Banda, Baya et Mandjia, « le Guyanais de l’Afrique », comme l’appellera le député de la Guyane Jean Galmot, entend montrer que la pensée des peuples sans machines et sans écriture est en réalité parfaitement complexe et élaborée. Félix Eboué pousse ses divergences avec la vieille tradition ethnographique jusqu’à mettre en garde Léon Damas, chargé, en 1934, par le professeur Paul Rivet - Fondateur du Musée de l’Homme - d’une mission ethnologique sur les survivances africaines en Guyane. « Ne laissons pas aux explorateurs, souvent douteux, le soin de nous diviser. La Guyane, notre terre natale, a vocation à garantir l’émancipation de toutes ses composantes par le savoir », plaide-t-il auprès du chantre de la négritude. Comme pour mieux préciser sa pensée, il cite l’exemple du marron Gabriel. En rébellion contre le système esclavagiste, ce dernier, d’origine amérindienne, va mobiliser à Tonnégrande, son fief, tout à la fois des Noirs et des Amérindiens.
Le vrai Félix Eboué est là. Si peu dans le rythme de sa génération. A l’écart. Original. Différent. Singulier et en même temps classique. Déterminé bien qu’amoureux des chemins de traverse. Jusqu’à parfois provoquer lui-même la méprise. Ne lui reproche-t-on pas d’avoir réquisitionné des hommes pour la construction du chemin de fer Congo-Océan ? L’accuser d’avoir recours aux travaux forcés c’est ignorer, à dire vrai, que Félix Eboué incarne à lui seul une promesse d’harmonie retrouvée, que son image d’homme de terrain ne fait que renforcer. Tout à la fois haut fonctionnaire, collègue, citoyen, ami, homme noir, Félix Eboué, en Afrique comme aux Antilles, fonctionne sur le registre de la concertation et du respect des traditions. Quand on discute, on avance, et quand on écoute, on parvient toujours à convaincre. La notion de contrainte, dès lors que tout est affaire de volonté, est écartée d’emblée au profit de celle d’effort. Plus qu’une révolution, il s’agit là une restauration. Plus qu’un programme, c’est une ligne de conduite. Pour installer cette posture, il fallait trouver les mots qui la résument et la fassent comprendre. Félix Eboué les a trouvés d’instinct, en 1936, en Guadeloupe, où il est chargé d’appliquer les réformes politiques et sociales du Front populaire. A des ouvriers agricoles en grève, à Sainte-Rose, il choisit de parler de responsabilité, de fierté, de dignité, de lucidité. Et emporte la mise sans coup férir.
Mais la déception finit par le gagner. Sa carrière n’avance pas. Ses états de service sont excellents mais il n’est jamais récompensé. Le préjugé de race fait encore recette. Au reste, quand ils sont à la mode, les préjugés n’ont pas besoin d’être explicités. Il leur suffit d’être assenés. La dernière fois qu’il rencontre René Maran, Félix Eboué lui cite Rousseau, qui disait qu’avec le temps les idées devenaient des sensations. Les siennes sont soudainement pessimistes sur un monde voué, croit-il, à une lente et sûre autodestruction. Mais il lit le poète cayennais Ismaël Urbain, le compare à Mallarmé et, au moment où l’âge commence à lui inspirer le détachement de toutes les vanités, il se sent comme inspiré par une raison « cosmique et non mystique » de survivre.
Il faut dire que René Maran est son homme de confiance. Ils se sont connus au Lycée Montaigne de Bordeaux où, revêtus de l’uniforme gris ardoise des internes, ils se sont employés « à demeurer les meilleurs ». Ils se sont retrouvés, en 1918, à Ouaka, l’une des plus grandes circonscriptions de l’Afrique équatoriale. A Bordeaux, cependant, Félix Eboué et René Maran étaient déjà des hommes de culture, c’est-à-dire des hommes intégraux à la manière des Grecs, férus de musique et de sport. Eboué excelle au football. Mais s’il admire Maran, qui, lui, préfère le rugby, c’est parce que ce dernier, à ses yeux, est un génie de la plume. Pour Félix Eboué, René Maran est d’abord un journaliste de premier ordre, qui sait alterner dans ses éditoriaux l’analyse, le portrait, la réflexion, l’apostrophe. Il frappe. Il taille. Il pourfend. Tout cela, avec un égal talent. Gaston Monnerville l’apprendra à ses dépens. Dans Précisions utiles et vérités oubliées, une tribune que fait paraître Temps nouveaux, le journal des amis de René Jadfard, René Maran dispute à Gaston Monnerville la paternité de la victoire du procès, à Nantes en 1932, des émeutiers de Cayenne. Cette tribune, Félix Eboué la garde précieusement dans un tiroir de son bureau, à portée de main. Il y voit l’exemple même du pamphlet que l’on enseigne dans les meilleures écoles de lettres : la contre-argumentation, sur un ton des plus caustiques, sans jamais verser dans la diffamation. Chez l’auteur d’Un homme pareil aux autres, le gouverneur de l’AEF voit également un précieux écrivain-voyageur. Un homme qui observe d’abord. Qui retient. Et puis qui écrit. Le sens de l’ellipse n’est pas son fort. Ce serait même son faible, s’il y succombait. En bref, Félix Eboué sait que tous les détails importent. La vérité littéraire et géographique est à ce prix. Rien de pire qu’un voyageur pressé. Pressé de quoi ? De rentrer ? Il aurait mieux fait dans ce cas de ne jamais partir. Seule la flânerie ménage des surprises, et mérite donc d’être rapportée tout aussi patiemment.
Oui, seule la flânerie ménage des surprises. Lorsqu’il débarque en Guyane, en juillet 1921, l’année même où René Maran obtient le Goncourt avec Batouala, Félix Eboué est fortement habité par cette idée, qu’il va bientôt mettre en pratique. A Cayenne et à Saint-Laurent il se met à écrire, s’étonnant de la facilité avec laquelle les phrases, si longtemps contenues, coulent et débordent, sans jamais cesser de tourner métaphoriquement autour de l’espace, l’aventure, la liberté. Et, au bout du compte, les deux ou trois récits qu’il jette sur le papier ressemblent à des livres à l’ancienne, avec pleins et déliés, écrits par un élégiaque enjoué au rythme lent des jours qui passent, et dont la prose, sensible à la météorologie, semble accompagner le moindre mouvement de la nature environnante et traduire, à la perfection, chaque parfum. Car Félix Eboué se découvre un nez incroyable. Les yeux fermés, il reconnaît, à l’odeur, la fraîcheur de l’hibiscus, la clarté du buisson ardent, l’exquis du bois de rose. Pendant son séjour en Guyane, le Cayennais a reconstitué sa mémoire olfactive et sensitive. Il l’a restituée dans des récits boisés et capiteux, qui parfois même étourdissent. Sans doute la preuve que ce qui rend Eboué si attachant, c’est sa prodigieuse sensibilité. Qu’il s’agisse de l’art, des lectures, des paysages, il fait montre d’une sorte de maîtrise digne des grands classiques. Rien n’est plus émouvant, par exemple, que le passage où Félix Eboué décrit son émotion en lisant Atipa, le roman en créole guyanais d’Alfred Parépou. Il y a là comme un transport racinien et comme un émerveillement amoureux. Comment un roman social peut-il susciter ce qu’Edgard Nibul n’allait chercher que dans la musique ?
On devine que l’inspiration de Félix Eboué a d’autres raisons. En 1922, de nouveau en vacances au pays, il épouse, à Saint-Laurent, Eugénie Tell en même temps qu’il est initié, à Cayenne, franc-maçon, à la loge La France Equinoxiale. Et là la plume du nouveau marié devient proprement aérienne, fluide, irrépressible. Il adore la Guyane, d’un amour irraisonné, charnel, viscéral, comme il idéalise la femme de ses rêves. Pendant ses congés, il se consacre, pour l’essentiel, à regarder le Maroni avec des yeux de peintre. Il va écrire sur la lumière un récit de contemplatif. Dans les bras d’Eugénie et les odeurs fortes des goyaviers, Eboué se désencombre de son passé, se déleste de son futur, s’oublie dans le présent. A la jonction du ciel, de la terre et de l’eau, entre la maison de ses beaux-parents à Saint-Laurent et celle de sa mère à Cayenne, le temps semble s’être arrêté, comme en suspension, à peine bousculé par les visites quotidiennes des élus politiques. Car toute la Guyane bruisse du retour de l’enfant prodige. Face à ses visiteurs, qui le pressent de questions, Félix Eboué choisit in fine de privilégier l’écoute. Cependant l’un d’eux retiendra toute son attention. Il s’agit de Jean Galmot. Pour le député de la Guyane, en guerre ouverte avec Eugène Gober, le Maire de Cayenne, l’ambition coloniale française est discontinue et toujours hasardeuse. L’européo-centrisme, de fait, bouche l’horizon et fait dénier toute singularité au colonisé, nier la violence de sa mise sous tutelle, sous prétexte d’universalisme bien entendu, c’est-à-dire profitable d’abord aux puissances européennes. Le franco-centrisme, constant lui aussi, réduit les enjeux coloniaux à ceux de la seule Métropole. L’égoïsme national ne cessera pas de primer.
Léon Damas, lui, ira bien plus loin. En réponse à la mise en garde de Félix Eboué, il va lui adresser une longue lettre qui, à bien des égards, va inspirer son rapport de mission mais surtout son ouvrage inaugural, Retour de Guyane, paru en 1938. La civilisation occidentale, souligne l’écrivain guyanais dans ce livre, constitue une réponse parmi d’autres au problème humain, pas forcément la plus estimable, et son expansion irrépressible pourrait bien annoncer une véritable catastrophe anthropologique.
Que pense de tout cela Félix Eboué ? Il se confie peu à ses amis, parfois à son épouse, souvent à son Journal. Pendant ses congés en Guyane, sur son vaste secrétaire en bois rouge de notaire américain, il écrit, en effet, des pages entières, parfois jusque tard dans la nuit. D’ailleurs il ne quitte guère la fraîcheur de la maison familiale, ni l’ombre de ses frondaisons. Seule Madame Eboué va au marché, de bon matin, d’où elle rapporte des légumes frais et les nouvelles du monde. Au fond, Félix Eboué est convaincu d’une chose : la grande leçon de sa nomination à la tête de l’Afrique Equatoriale Française aura été de faire condamner par les héritiers des esclavagistes les péchés qu’il croyait lui-même ineffaçables de l’esclavage et du racisme, tout en conservant ce que la France avait de meilleur, la méritocratie, et en promettant de bannir ce qu’elle avait de pire, le règne arrogant du jacobinisme.
Cette question, Félix Eboué l’a retournée en tous sens avec des interlocuteurs aussi éminents que critiques. Aucun d’eux ne l’a détourné d’une conviction qui s’est enracinée avec les années. D’autant que du marxisme, sa pensée a hérité de l’idée que toute conscience sociale est trompeuse et que l’existence pratique des hommes conditionne leurs productions psychiques. Du freudisme, celle que même les expressions en apparence les plus arbitraires voire absurdes de l’esprit peuvent être déchiffrées. Félix Eboué n’engage rien par hasard. Il étudie ses dossiers comme un étudiant qui a un examen à passer le lendemain. Franc-maçon, il est aussi membre de la SFIO et de la Ligue des Droits de l’Homme et du Citoyen. A la devise de la République : Liberté-Egalité-Fraternité, il préfère : Légalité-Neutralité-Equité. Il est devenu anguleux, encore plus méthodique, se montre tout à la fois lesté et distancié. Grâce à son appétit pour le théâtre, pour la littérature et pour la peinture, à sa pratique des langues étrangères, à sa passion pour la Grèce antique, à son goût, jusqu’au bout, de fréquenter, la plume à la main, les plus grands esprits. Ne boudons pas notre plaisir : lorsqu’on lit Jouer le jeu, ce discours prononcé, le 1er juillet 1937, à l’occasion de la distribution des prix du Lycée Carnot à Pointe-à-Pitre, on se sent littéralement happé par l’écriture de Félix Eboué. Et même saisi par l’étrange impression d’assister au surgissement d’une pensée nouvelle, comme si ce texte, qui a déjà marqué plusieurs générations de lecteurs, était doté d’une éternelle jeunesse.
Que dit-il, ce texte ? Que l’idéal n’est pas de choisir entre le bien et le mal, mais entre le moins mauvais et le pire pour pouvoir vivre ensemble. Ce n’est pas seulement que le monde est appelé à devenir multipolaire et la Guyane, à l’image de l’Hexagone, multiraciale et multiculturelle. C’est que la définition d’un ennemi de race étant une aberration, le problème va être de concilier l’universalité des valeurs et la diversité des cultures.
Voilà un itinéraire parcouru, de la colonisation à la Seconde Guerre Mondiale, par toutes les passions de son temps ; un homme impliqué dans la victoire des alliés ; un Gouverneur général qui va freiner la progression allemande en Afrique ; un Guyanais qui va changer le cours du conflit en coupant à l’ennemi la route du pétrole ; un Cayennais qui va inspirer la politique africaine du Général de Gaulle ; un passionné d’ethnologie et d’anthropologie qui va mettre à mal les thèses alors en vigueur dans ces deux disciplines. Et voici que la mémoire collective le réduit aujourd’hui à quelques silhouettes caricaturales : le premier gouverneur noir ; l’administrateur colonial petit-fils d’esclave ; le franc-maçon qui rallie la France Libre du général de Gaulle ; le Compagnon de la Libération ; le membre du Conseil de Défense de l’Empire ; l’auteur de Jouer le jeu. La complexité de Félix Eboué se dissout même sur la place des Palmistes où sa statue, érigée il y a plus de 60 ans, arbore la triste expression de la photo jaunie d’un fils qu’une guerre n’a pas rendu.
Donc on est heureux chaque fois qu’un regard neuf, affranchi des répétitions paresseuses, nous donne à penser qu’il va restituer la richesse de ce tempérament et de cette trace. Au surplus, l’heure est favorable. Le 10 juin, la Guyane, pays natal de Félix Eboué, va commémorer à son tour l’abolition de l’esclavage. Et en cette année 2009, moult cérémonies rendent hommage à la fois au 60ème anniversaire de l’entrée de ses cendres au Panthéon et au 65ème anniversaire de sa mort. Cet opportun et salutaire hommage n’aurait certainement pas été possible en Guyane sans le Cercle Félix Eboué1, créé le 26 avril 2008. On peut compter sur son président, Yvan Chérica, pour qu’un des sociétaires du Cercle nous livre un jour non une biographie hagiographique mais l’analyse détaillée des débats historiographiques que suscite la vie de Félix Eboué.
En attendant, je me suis, pour ma part, royalement replongé dans Félix Eboué : Grand commis et loyal serviteur, cette biographie de René Maran que j’avais déjà annotée à presque chaque page, un peu comme ce dernier avait fait lui-même sur un manuscrit, au titre illisible, qu’il avait donné à lire à Eboué. Pendant la lecture de ce manuscrit, Eboué, il est vrai, n’avait cessé de dialoguer avec Maran sur un sujet qui lui était cher et qui d’ailleurs les obsédait tous les deux : le centralisme républicain et sa façon de préserver ce que l’on peut appeler en Guyane aujourd’hui l’identité régionale. Qu’est-ce qu’un Guyanais ? Quelqu’un qui l’est ou quelqu’un qui veut l’être ? Est-ce l’enracinement dans un passé régional ou le vouloir-vivre ensemble de chaque individu ?
A dire vrai, c’est parce qu’il n’aspirait à n’être point remarqué que Félix Eboué détonnait vraiment. Ce n’était pas tant qu’il fût noir, plus âgé que nombre de ses camarades de classe, plus consciencieux aussi, et presque trop souriant, c’est qu’il semblait venir d’un autre monde et ne faire que passer.
Dans cette Ecole coloniale du début des années 1900, on forme encore l’élite des administrateurs de la France d’Outre-Mer. L’établissement sent le vieux bois ciré. On y enseigne l’épistémologie, l’esthétique, l’arithmétique, l’histoire de la France éternelle, l’histoire de l’Empire. En classe, Félix Eboué seul met une rigueur de bénédictin à remplir de grands cahiers, à ne rien perdre de ce qu’on lui enseigne. Il ne prend pas de notes, il s’en gargarise. C’est probablement là que, mieux que les autres, il a conceptualisé l’altérité, la différence, la comparaison, l’accouchement du Moi par l’Autre.
Car on peut comprendre l’autre. Cette vérité première, Félix Eboué s’appliquera à l’expliquer à ses collègues, médusés, à Madagascar puis en Oubangui-Chari, ses deux premières affectations. On peut découvrir chez l’autre, précise-t-il aux fonctionnaires coloniaux, un ensemble de faits psychiques échappant à la conscience non éloigné du vôtre. La pensée sauvage n’est pas la pensée des sauvages, mais une pensée non encore domestiquée. De ce point de vue, l’ethnie, l’ethnicité ou l’ethnisme lui apparaîtront vite comme des catégories par trop réductrices. Dans un courrier adressé, à Paris, à un ami siégeant au bureau de la Ligue des Droits de l’Homme et du Citoyen, il écrit qu’enfermer les Africains dans un carcan ethnique est le pire service qu’on peut leur rendre. Les ethnies ne sont pas des essences, mais des processus. A Gaston Monnerville qui, à la tête d’une mission parlementaire d’enquête, lui rend visite au Tchad, il fait lire volontiers son Journal dans lequel il applique la formule de Renan sur les nations aux ethnies : « Les nations naissent et meurent ». Il en est de même pour les ethnies. Les derniers gardiens du temple ethnique sont les ethnologues et… les collectionneurs d’art africain. On l’a compris, la religion de Félix Eboué est faite. C’est à travers essentiellement le témoignage des Africains qu’il va lire la vraie histoire de l’Afrique et donc s’affranchir du réductionnisme ethnographique. Lorsque, en 1918, il fait publier une étude sur les langues Sango, Banda, Baya et Mandjia, « le Guyanais de l’Afrique », comme l’appellera le député de la Guyane Jean Galmot, entend montrer que la pensée des peuples sans machines et sans écriture est en réalité parfaitement complexe et élaborée. Félix Eboué pousse ses divergences avec la vieille tradition ethnographique jusqu’à mettre en garde Léon Damas, chargé, en 1934, par le professeur Paul Rivet - Fondateur du Musée de l’Homme - d’une mission ethnologique sur les survivances africaines en Guyane. « Ne laissons pas aux explorateurs, souvent douteux, le soin de nous diviser. La Guyane, notre terre natale, a vocation à garantir l’émancipation de toutes ses composantes par le savoir », plaide-t-il auprès du chantre de la négritude. Comme pour mieux préciser sa pensée, il cite l’exemple du marron Gabriel. En rébellion contre le système esclavagiste, ce dernier, d’origine amérindienne, va mobiliser à Tonnégrande, son fief, tout à la fois des Noirs et des Amérindiens.
Le vrai Félix Eboué est là. Si peu dans le rythme de sa génération. A l’écart. Original. Différent. Singulier et en même temps classique. Déterminé bien qu’amoureux des chemins de traverse. Jusqu’à parfois provoquer lui-même la méprise. Ne lui reproche-t-on pas d’avoir réquisitionné des hommes pour la construction du chemin de fer Congo-Océan ? L’accuser d’avoir recours aux travaux forcés c’est ignorer, à dire vrai, que Félix Eboué incarne à lui seul une promesse d’harmonie retrouvée, que son image d’homme de terrain ne fait que renforcer. Tout à la fois haut fonctionnaire, collègue, citoyen, ami, homme noir, Félix Eboué, en Afrique comme aux Antilles, fonctionne sur le registre de la concertation et du respect des traditions. Quand on discute, on avance, et quand on écoute, on parvient toujours à convaincre. La notion de contrainte, dès lors que tout est affaire de volonté, est écartée d’emblée au profit de celle d’effort. Plus qu’une révolution, il s’agit là une restauration. Plus qu’un programme, c’est une ligne de conduite. Pour installer cette posture, il fallait trouver les mots qui la résument et la fassent comprendre. Félix Eboué les a trouvés d’instinct, en 1936, en Guadeloupe, où il est chargé d’appliquer les réformes politiques et sociales du Front populaire. A des ouvriers agricoles en grève, à Sainte-Rose, il choisit de parler de responsabilité, de fierté, de dignité, de lucidité. Et emporte la mise sans coup férir.
Mais la déception finit par le gagner. Sa carrière n’avance pas. Ses états de service sont excellents mais il n’est jamais récompensé. Le préjugé de race fait encore recette. Au reste, quand ils sont à la mode, les préjugés n’ont pas besoin d’être explicités. Il leur suffit d’être assenés. La dernière fois qu’il rencontre René Maran, Félix Eboué lui cite Rousseau, qui disait qu’avec le temps les idées devenaient des sensations. Les siennes sont soudainement pessimistes sur un monde voué, croit-il, à une lente et sûre autodestruction. Mais il lit le poète cayennais Ismaël Urbain, le compare à Mallarmé et, au moment où l’âge commence à lui inspirer le détachement de toutes les vanités, il se sent comme inspiré par une raison « cosmique et non mystique » de survivre.
Il faut dire que René Maran est son homme de confiance. Ils se sont connus au Lycée Montaigne de Bordeaux où, revêtus de l’uniforme gris ardoise des internes, ils se sont employés « à demeurer les meilleurs ». Ils se sont retrouvés, en 1918, à Ouaka, l’une des plus grandes circonscriptions de l’Afrique équatoriale. A Bordeaux, cependant, Félix Eboué et René Maran étaient déjà des hommes de culture, c’est-à-dire des hommes intégraux à la manière des Grecs, férus de musique et de sport. Eboué excelle au football. Mais s’il admire Maran, qui, lui, préfère le rugby, c’est parce que ce dernier, à ses yeux, est un génie de la plume. Pour Félix Eboué, René Maran est d’abord un journaliste de premier ordre, qui sait alterner dans ses éditoriaux l’analyse, le portrait, la réflexion, l’apostrophe. Il frappe. Il taille. Il pourfend. Tout cela, avec un égal talent. Gaston Monnerville l’apprendra à ses dépens. Dans Précisions utiles et vérités oubliées, une tribune que fait paraître Temps nouveaux, le journal des amis de René Jadfard, René Maran dispute à Gaston Monnerville la paternité de la victoire du procès, à Nantes en 1932, des émeutiers de Cayenne. Cette tribune, Félix Eboué la garde précieusement dans un tiroir de son bureau, à portée de main. Il y voit l’exemple même du pamphlet que l’on enseigne dans les meilleures écoles de lettres : la contre-argumentation, sur un ton des plus caustiques, sans jamais verser dans la diffamation. Chez l’auteur d’Un homme pareil aux autres, le gouverneur de l’AEF voit également un précieux écrivain-voyageur. Un homme qui observe d’abord. Qui retient. Et puis qui écrit. Le sens de l’ellipse n’est pas son fort. Ce serait même son faible, s’il y succombait. En bref, Félix Eboué sait que tous les détails importent. La vérité littéraire et géographique est à ce prix. Rien de pire qu’un voyageur pressé. Pressé de quoi ? De rentrer ? Il aurait mieux fait dans ce cas de ne jamais partir. Seule la flânerie ménage des surprises, et mérite donc d’être rapportée tout aussi patiemment.
Oui, seule la flânerie ménage des surprises. Lorsqu’il débarque en Guyane, en juillet 1921, l’année même où René Maran obtient le Goncourt avec Batouala, Félix Eboué est fortement habité par cette idée, qu’il va bientôt mettre en pratique. A Cayenne et à Saint-Laurent il se met à écrire, s’étonnant de la facilité avec laquelle les phrases, si longtemps contenues, coulent et débordent, sans jamais cesser de tourner métaphoriquement autour de l’espace, l’aventure, la liberté. Et, au bout du compte, les deux ou trois récits qu’il jette sur le papier ressemblent à des livres à l’ancienne, avec pleins et déliés, écrits par un élégiaque enjoué au rythme lent des jours qui passent, et dont la prose, sensible à la météorologie, semble accompagner le moindre mouvement de la nature environnante et traduire, à la perfection, chaque parfum. Car Félix Eboué se découvre un nez incroyable. Les yeux fermés, il reconnaît, à l’odeur, la fraîcheur de l’hibiscus, la clarté du buisson ardent, l’exquis du bois de rose. Pendant son séjour en Guyane, le Cayennais a reconstitué sa mémoire olfactive et sensitive. Il l’a restituée dans des récits boisés et capiteux, qui parfois même étourdissent. Sans doute la preuve que ce qui rend Eboué si attachant, c’est sa prodigieuse sensibilité. Qu’il s’agisse de l’art, des lectures, des paysages, il fait montre d’une sorte de maîtrise digne des grands classiques. Rien n’est plus émouvant, par exemple, que le passage où Félix Eboué décrit son émotion en lisant Atipa, le roman en créole guyanais d’Alfred Parépou. Il y a là comme un transport racinien et comme un émerveillement amoureux. Comment un roman social peut-il susciter ce qu’Edgard Nibul n’allait chercher que dans la musique ?
On devine que l’inspiration de Félix Eboué a d’autres raisons. En 1922, de nouveau en vacances au pays, il épouse, à Saint-Laurent, Eugénie Tell en même temps qu’il est initié, à Cayenne, franc-maçon, à la loge La France Equinoxiale. Et là la plume du nouveau marié devient proprement aérienne, fluide, irrépressible. Il adore la Guyane, d’un amour irraisonné, charnel, viscéral, comme il idéalise la femme de ses rêves. Pendant ses congés, il se consacre, pour l’essentiel, à regarder le Maroni avec des yeux de peintre. Il va écrire sur la lumière un récit de contemplatif. Dans les bras d’Eugénie et les odeurs fortes des goyaviers, Eboué se désencombre de son passé, se déleste de son futur, s’oublie dans le présent. A la jonction du ciel, de la terre et de l’eau, entre la maison de ses beaux-parents à Saint-Laurent et celle de sa mère à Cayenne, le temps semble s’être arrêté, comme en suspension, à peine bousculé par les visites quotidiennes des élus politiques. Car toute la Guyane bruisse du retour de l’enfant prodige. Face à ses visiteurs, qui le pressent de questions, Félix Eboué choisit in fine de privilégier l’écoute. Cependant l’un d’eux retiendra toute son attention. Il s’agit de Jean Galmot. Pour le député de la Guyane, en guerre ouverte avec Eugène Gober, le Maire de Cayenne, l’ambition coloniale française est discontinue et toujours hasardeuse. L’européo-centrisme, de fait, bouche l’horizon et fait dénier toute singularité au colonisé, nier la violence de sa mise sous tutelle, sous prétexte d’universalisme bien entendu, c’est-à-dire profitable d’abord aux puissances européennes. Le franco-centrisme, constant lui aussi, réduit les enjeux coloniaux à ceux de la seule Métropole. L’égoïsme national ne cessera pas de primer.
Léon Damas, lui, ira bien plus loin. En réponse à la mise en garde de Félix Eboué, il va lui adresser une longue lettre qui, à bien des égards, va inspirer son rapport de mission mais surtout son ouvrage inaugural, Retour de Guyane, paru en 1938. La civilisation occidentale, souligne l’écrivain guyanais dans ce livre, constitue une réponse parmi d’autres au problème humain, pas forcément la plus estimable, et son expansion irrépressible pourrait bien annoncer une véritable catastrophe anthropologique.
Que pense de tout cela Félix Eboué ? Il se confie peu à ses amis, parfois à son épouse, souvent à son Journal. Pendant ses congés en Guyane, sur son vaste secrétaire en bois rouge de notaire américain, il écrit, en effet, des pages entières, parfois jusque tard dans la nuit. D’ailleurs il ne quitte guère la fraîcheur de la maison familiale, ni l’ombre de ses frondaisons. Seule Madame Eboué va au marché, de bon matin, d’où elle rapporte des légumes frais et les nouvelles du monde. Au fond, Félix Eboué est convaincu d’une chose : la grande leçon de sa nomination à la tête de l’Afrique Equatoriale Française aura été de faire condamner par les héritiers des esclavagistes les péchés qu’il croyait lui-même ineffaçables de l’esclavage et du racisme, tout en conservant ce que la France avait de meilleur, la méritocratie, et en promettant de bannir ce qu’elle avait de pire, le règne arrogant du jacobinisme.
Cette question, Félix Eboué l’a retournée en tous sens avec des interlocuteurs aussi éminents que critiques. Aucun d’eux ne l’a détourné d’une conviction qui s’est enracinée avec les années. D’autant que du marxisme, sa pensée a hérité de l’idée que toute conscience sociale est trompeuse et que l’existence pratique des hommes conditionne leurs productions psychiques. Du freudisme, celle que même les expressions en apparence les plus arbitraires voire absurdes de l’esprit peuvent être déchiffrées. Félix Eboué n’engage rien par hasard. Il étudie ses dossiers comme un étudiant qui a un examen à passer le lendemain. Franc-maçon, il est aussi membre de la SFIO et de la Ligue des Droits de l’Homme et du Citoyen. A la devise de la République : Liberté-Egalité-Fraternité, il préfère : Légalité-Neutralité-Equité. Il est devenu anguleux, encore plus méthodique, se montre tout à la fois lesté et distancié. Grâce à son appétit pour le théâtre, pour la littérature et pour la peinture, à sa pratique des langues étrangères, à sa passion pour la Grèce antique, à son goût, jusqu’au bout, de fréquenter, la plume à la main, les plus grands esprits. Ne boudons pas notre plaisir : lorsqu’on lit Jouer le jeu, ce discours prononcé, le 1er juillet 1937, à l’occasion de la distribution des prix du Lycée Carnot à Pointe-à-Pitre, on se sent littéralement happé par l’écriture de Félix Eboué. Et même saisi par l’étrange impression d’assister au surgissement d’une pensée nouvelle, comme si ce texte, qui a déjà marqué plusieurs générations de lecteurs, était doté d’une éternelle jeunesse.
Que dit-il, ce texte ? Que l’idéal n’est pas de choisir entre le bien et le mal, mais entre le moins mauvais et le pire pour pouvoir vivre ensemble. Ce n’est pas seulement que le monde est appelé à devenir multipolaire et la Guyane, à l’image de l’Hexagone, multiraciale et multiculturelle. C’est que la définition d’un ennemi de race étant une aberration, le problème va être de concilier l’universalité des valeurs et la diversité des cultures.
René Ladouceur
Juin 2009
1. Cercle Félix Eboué : BP 90 - 97364 Remire-Montjoly - Tel/fax : 0594 38 07 54.
Novembre 2008 : Au pays du bonheur tranquille
Juillet 2008 : Mon impromptu de juillet
Mai 2008 : Et si on relisait Elie Stephenson ?
Janvier 2008 : René Maran plus actuel que jamais
Septembre 2007 : La Question africaine
Juillet 2007 : Un si doux ennui
Janvier 2007 : Entre histoire et mémoire
Octobre 2006 : Notre grand voisin
Juillet 2006 : Le Foot-patriotisme
Juillet 2006 : Sous l'agression, la dignité
Mai 2006 : Adieu l'ami (un hommage à Jerry René-Corail)
Mars 2006 : Lettre ouverte à René Maran
Mars 2006 : Non à la régression
Janvier 2006 : Vive le débat
Juillet 2008 : Mon impromptu de juillet
Mai 2008 : Et si on relisait Elie Stephenson ?
Janvier 2008 : René Maran plus actuel que jamais
Septembre 2007 : La Question africaine
Juillet 2007 : Un si doux ennui
Janvier 2007 : Entre histoire et mémoire
Octobre 2006 : Notre grand voisin
Juillet 2006 : Le Foot-patriotisme
Juillet 2006 : Sous l'agression, la dignité
Mai 2006 : Adieu l'ami (un hommage à Jerry René-Corail)
Mars 2006 : Lettre ouverte à René Maran
Mars 2006 : Non à la régression
Janvier 2006 : Vive le débat
Raccourcis


passer une petite annonce

passer une annonce de covoiturage


passer une annonce d’emploi

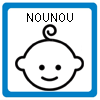





associations, postez vos actualités
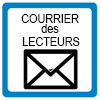
participez au courrier des lecteurs
La Guyane c’est ici
La qualité de l’Air avec
ATMO
Photothèque

Lancements 2022
Vol 259 Ariane 5