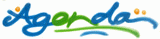Blada.com
Il est 16:57 en Guyane
vendredi 18 avril
vendredi 18 avril
le marron - chroniques atypiques de la guyane française
Chroniques
- Année 2021 (1)
- Année 2020 (2)
- Année 2019 (4)
- Année 2017 (1)
- Année 2014 (4)
- Année 2013 (9)
- Année 2012 (4)
- Année 2011 (6)
- Année 2010 (10)
- Année 2009 (12)
- Année 2008 (18)
- Année 2007 (12)
- Année 2006 (24)
- Année 2005 (18)
- Année 2004 (13)
- Année 2003 (6)
- Année 2002 (4)
- Année 2001 (6)
- Année 2000 (3)

Par René Ladouceur
Si les pays désenchantés n’ont pas d’histoire, la Guyane est bien le seul qui en ait une. Et aujourd’hui, elle ne se déroule ni à Paris, ni à Nantes, ni à Bordeaux. Vindicative ou lasse de promesses, rebelle ou désormais trop méfiante, la Guyane a obligé Paris à ajourner le projet Cambior, ce qui est une victoire. Mais tout en se gardant, tant dans la rue que dans les assemblées délibérantes, de manifester bruyamment sa joie, c’est ce que l’on appelle le signe annonciateur d’une mutation sociologique. Que retiendra-t-on encore de ce trop joli mois d’octobre, où les Guyanais se sont ébroués dans leur somptueux paysage avec une paresse étincelante et un engourdissement provoqué ? Le Festival de jazz de Cayenne. La biennale du Marronnage de Matoury. Le dîner de con, de Francis Véber, au Zéphyr. Huis clos, de Jean-Paul Sartre, à l’Encre. Et cette phrase de Rousseau citée par Lévi-Strauss dans un récent numéro du Nouvel Observateur : « Il vient un moment où les idées sont remplacées par des sensations ». Le croiriez-vous ? Tandis que nous en sommes encore à commenter fiévreusement la délivrance d’un permis de recherche minière à la société Rexma, le monde continue de tourner. L’insolent ! Le grand souffle de liberté qui s’est levé en 1989 à Berlin, puis à Moscou, continue de balayer la planète. L’une après l’autre, les dictatures d’Amérique latine se sont effondrées. Le Paraguay n’est évidemment pas le Danemark ni le Venezuela de Chavez, la Suède. Cependant, la tendance, partout, est davantage au populisme qu’à la dictature. Et depuis que Lula, le 1er octobre dernier, a été contraint à un deuxième tour pour la présidentielle, personne ne doute plus que le Brésil, notre grand voisin, ait réussi sa mue démocratique.
Paris, pour sa part, a entrepris depuis longtemps de faire la cour au Brésil. A telle enseigne que, lors de la visite à Brasilia de Jacques Chirac, en mai dernier, Lula a annoncé sa décision d’organiser en 2009 « une année de la France au Brésil », à la suite du succès, en 2005, de « l’année du Brésil en France ». Il est vrai que nous paraissons nous résigner à une recette de sagesse selon laquelle les Etats auraient des intérêts, les représentants du peuple des préjugés, et les opinions publiques des humeurs. Au nom de quoi il faudrait oublier que le Brésil fait litière de l’émigration de ses ressortissants en Guyane. Human Rights Watch, l'organisation de défense des droits de l'homme basée à New York, et la gauche du Parti des Travailleurs, le parti de Lula, s’indignent lorsqu’on évoque « le recul de la misère » au Brésil sous prétexte que le salaire minimum est passé de 85 à 125 euros mensuels, comme le montrent les reportages aseptisés de RFO-Guyane. La forêt guyanaise, rappellent-ils, est pleine de miséreux brésiliens qui, dans l’espoir d’empocher un seul gramme d’or, sont chaque jour plus nombreux à déboiser, polluer les fleuves, se prostituer, s’entretuer. Curieusement, cette sinistre actualité sur le territoire guyanais n’est jamais évoquée dans la campagne électorale brésilienne actuelle, même dans les joutes qui mettent aux prises les candidats au poste de gouverneur dans l’Etat du Para, à la frontière de Saint-Georges de l’Oyapock. Or personne n’ignore que les orpailleurs clandestins sont ravitaillés par des bases arrière implantées sur la rive brésilienne de l'Oyapock et, qui plus est, opèrent au mercure, cette substance interdite en Guyane depuis le 1er janvier sur les sites légaux. Avec l’accord, signé le 15 juillet 2005, sur la construction d’un pont routier sur l’Oyapock, un pas considérable est franchi dans le sens du cynisme de ces monstres froids que sont par définition les Etats. Jacques Chirac a beau souligner que rien ne se fait en Amérique du sud qui ne porte plus ou moins visiblement la trace du Brésil, les Guyanais peinent toujours à réaliser l’intérêt qu’ils pourront tirer de l’ouverture de leur frontière à leur encombrant voisin. A moins qu’il ne faille y voir la preuve que la politique internationale n’est qu’un rapport de force entre des Etats qui se soucient peu de leurs régions excentrées ? Du moins la sagesse des nations conduisait à le penser jusqu’à l’invention du concept du « devoir d’assistance ». Mais que faire lorsque l’autorité n’est pas au service du droit ? Pour Gaston Monnerville, il n’y avait qu’un seul intérêt à défendre, celui de la France comme Etat, et qu’une seule stratégie efficace, celle de « l’alliance de revers » : « Il faut toujours un allié de revers, disait-il. Les rois de France ont fait alliance avec le Grand Turc contre le Saint Empire romain germanique. De Gaulle a fait alliance avec la Russie pour la renforcer en face de l’Allemagne ». L’Hexagone, au détriment de la Guyane, est-elle en train de faire alliance avec le Brésil pour le renforcer en face des Etats-Unis ?
Il faut dire que Lula lui-même est pour beaucoup dans ce regain d’intérêt pour son pays. Elu en 2002, le président altermondialiste a apaisé les marchés par une stricte orthodoxie financière, calmé les militaires par son nationalisme sourcilleux et séduit les pauvres grâce à la bolsa familia, une sorte d’allocation familiale dont bénéficient plus de 40 millions de Brésiliens. Ce qui, à l’évidence, est à la fois archaïque et profond dans l’altermondialisme, c’est le rêve éternel de changer le monde, la société, et même de changer l’homme. Avec cette espérance ravivée, le pape Jean-Paul II avait rempli les cœurs, sinon les églises, et les stades, sinon les urnes. Si le XXè siècle a bien commencé avec la grande guerre de 1914-1918, il s’est achevé avec la chute du mur de Berlin, en 1989. On ne soulignera jamais assez le traumatisme créé par la capitulation en rase campagne et sans coup férir de l’empire soviétique. Sous le despotisme stalinien, les peuples vivaient un rêve que la démocratie capitaliste n’a que partiellement satisfait. L’émancipation a été vécue comme un phénomène immense et libérateur. Mais elle a réduit l’espérance au profit de la liberté. Or les hommes veulent se libérer mais ne veulent pas être libres. Ils ont besoin de croire que l’Histoire a un sens. Si la critique marxienne du capitalisme reste en grande partie opératoire, force est d’admettre qu’elle n’a rassemblé les foules que parce qu’elle impliquait une philosophie de l’Histoire optimiste et une confiance aveugle dans la fatalité du progrès. Ces concepts sont désormais frappés de nullité. Si bien que le problème des altermondialistes se résume à cette question : comment changer la société ici et maintenant, si l’on ne peut plus changer le monde, ni l’homme plus tard ?
Changer la société. L’accession de Lula au pouvoir n’a absolument rien changé au rythme de l’immigration brésilienne en Guyane. Tant s’en faut ! Et pour cause. La société brésilienne n’est toujours pas parvenue à tenir les promesses qu’autorisent un territoire immense, aux richesses variées, une population jeune et dynamique, une position culturelle exceptionnelle, au carrefour de trois sources d’inspiration, l’européenne, l’américaine et l’africaine. Ambassadeur de France dans les années 30, Paul Claudel, qui avait la vue perçante et la dent dure, a un jour laissé tomber : « Le Brésil, pays d’avenir…et qui le restera ». Comme en écho, De Gaulle a lâché un beau matin à Cayenne ce commentaire sans appel : « Ce pays n’est pas sérieux ». « Le géant du futur » a beau être la dixième puissance mondiale, son développement est loin de connaître le rythme impétueux qui fut jadis celui du Japon, et naguère celui de la Corée du Sud. Et il demeure, en 2006, le pays le plus inégalitaire de la planète.
Pour autant, ne tombons pas dans l’angélisme. L’inégalité sociale n’est pas, comme dirait mon ami Nestor Radjou, un obstacle rédhibitoire au décollage industriel. Le capitalisme est un moteur qui fonctionne à la différence de température entre le centre et la périphérie, conformément aux principes de la thermodynamique. Encore faut-il que l’ensemble des éléments soit constitué en système. Au Brésil, c’est bien là que le bât blesse. Pour s’en convaincre, il suffit de se promener du côté de Rio, où les plus riches vivent dans de splendides villas, entourées de barbelés parfois électrifiés et surmontés de miradors, et les plus pauvres s’entassent dans d’interminables fourmilières, qui vont de la maison en dur à la cabane en mou, en passant par tous les stades intermédiaires. On objectera - Et à raison ! - que de Montjoly à Matoury il y a aussi bien de la différence. Sans doute, mais à l’intérieur d’un réseau urbain et social continu, où l’histoire, à défaut du niveau de revenu, tient lieu de fédérateur. Cayenne est un espace défini, où les différents quartiers, les monuments publics, les institutions et les services composent un ensemble organique et cohérent, quand Bélem ressemble plutôt à une addition de molécules sans commencement ni fin. Pays-continent, le Brésil, à dire vrai, s'est construit à coups de projets pharaoniques : une capitale livrée clés en main, des routes transamazoniennes, des barrages gigantesques. Devenu puissance émergente, on le cite aujourd'hui aux côtés de la Chine, de l'Inde et de l'Afrique du Sud.
De ce Brésil, il y a peu de raisons d’en bouder la puissance régionale, mais aucune de ne pas en souhaiter l’unification. Peu de raisons donc de craindre les échanges avec lui, mais aucune raison, bien sûr et surtout, de s’étonner que nos opinions publiques manifestent de plus en plus leur inquiétude du peu de cas que Paris, dans ses relations avec Brasilia, fait des intérêts de la Guyane.
René Ladouceur
rene.ladouceur@wanadoo.fr
23 octobre 2006
Réagir à cet article
Paris, pour sa part, a entrepris depuis longtemps de faire la cour au Brésil. A telle enseigne que, lors de la visite à Brasilia de Jacques Chirac, en mai dernier, Lula a annoncé sa décision d’organiser en 2009 « une année de la France au Brésil », à la suite du succès, en 2005, de « l’année du Brésil en France ». Il est vrai que nous paraissons nous résigner à une recette de sagesse selon laquelle les Etats auraient des intérêts, les représentants du peuple des préjugés, et les opinions publiques des humeurs. Au nom de quoi il faudrait oublier que le Brésil fait litière de l’émigration de ses ressortissants en Guyane. Human Rights Watch, l'organisation de défense des droits de l'homme basée à New York, et la gauche du Parti des Travailleurs, le parti de Lula, s’indignent lorsqu’on évoque « le recul de la misère » au Brésil sous prétexte que le salaire minimum est passé de 85 à 125 euros mensuels, comme le montrent les reportages aseptisés de RFO-Guyane. La forêt guyanaise, rappellent-ils, est pleine de miséreux brésiliens qui, dans l’espoir d’empocher un seul gramme d’or, sont chaque jour plus nombreux à déboiser, polluer les fleuves, se prostituer, s’entretuer. Curieusement, cette sinistre actualité sur le territoire guyanais n’est jamais évoquée dans la campagne électorale brésilienne actuelle, même dans les joutes qui mettent aux prises les candidats au poste de gouverneur dans l’Etat du Para, à la frontière de Saint-Georges de l’Oyapock. Or personne n’ignore que les orpailleurs clandestins sont ravitaillés par des bases arrière implantées sur la rive brésilienne de l'Oyapock et, qui plus est, opèrent au mercure, cette substance interdite en Guyane depuis le 1er janvier sur les sites légaux. Avec l’accord, signé le 15 juillet 2005, sur la construction d’un pont routier sur l’Oyapock, un pas considérable est franchi dans le sens du cynisme de ces monstres froids que sont par définition les Etats. Jacques Chirac a beau souligner que rien ne se fait en Amérique du sud qui ne porte plus ou moins visiblement la trace du Brésil, les Guyanais peinent toujours à réaliser l’intérêt qu’ils pourront tirer de l’ouverture de leur frontière à leur encombrant voisin. A moins qu’il ne faille y voir la preuve que la politique internationale n’est qu’un rapport de force entre des Etats qui se soucient peu de leurs régions excentrées ? Du moins la sagesse des nations conduisait à le penser jusqu’à l’invention du concept du « devoir d’assistance ». Mais que faire lorsque l’autorité n’est pas au service du droit ? Pour Gaston Monnerville, il n’y avait qu’un seul intérêt à défendre, celui de la France comme Etat, et qu’une seule stratégie efficace, celle de « l’alliance de revers » : « Il faut toujours un allié de revers, disait-il. Les rois de France ont fait alliance avec le Grand Turc contre le Saint Empire romain germanique. De Gaulle a fait alliance avec la Russie pour la renforcer en face de l’Allemagne ». L’Hexagone, au détriment de la Guyane, est-elle en train de faire alliance avec le Brésil pour le renforcer en face des Etats-Unis ?
Il faut dire que Lula lui-même est pour beaucoup dans ce regain d’intérêt pour son pays. Elu en 2002, le président altermondialiste a apaisé les marchés par une stricte orthodoxie financière, calmé les militaires par son nationalisme sourcilleux et séduit les pauvres grâce à la bolsa familia, une sorte d’allocation familiale dont bénéficient plus de 40 millions de Brésiliens. Ce qui, à l’évidence, est à la fois archaïque et profond dans l’altermondialisme, c’est le rêve éternel de changer le monde, la société, et même de changer l’homme. Avec cette espérance ravivée, le pape Jean-Paul II avait rempli les cœurs, sinon les églises, et les stades, sinon les urnes. Si le XXè siècle a bien commencé avec la grande guerre de 1914-1918, il s’est achevé avec la chute du mur de Berlin, en 1989. On ne soulignera jamais assez le traumatisme créé par la capitulation en rase campagne et sans coup férir de l’empire soviétique. Sous le despotisme stalinien, les peuples vivaient un rêve que la démocratie capitaliste n’a que partiellement satisfait. L’émancipation a été vécue comme un phénomène immense et libérateur. Mais elle a réduit l’espérance au profit de la liberté. Or les hommes veulent se libérer mais ne veulent pas être libres. Ils ont besoin de croire que l’Histoire a un sens. Si la critique marxienne du capitalisme reste en grande partie opératoire, force est d’admettre qu’elle n’a rassemblé les foules que parce qu’elle impliquait une philosophie de l’Histoire optimiste et une confiance aveugle dans la fatalité du progrès. Ces concepts sont désormais frappés de nullité. Si bien que le problème des altermondialistes se résume à cette question : comment changer la société ici et maintenant, si l’on ne peut plus changer le monde, ni l’homme plus tard ?
Changer la société. L’accession de Lula au pouvoir n’a absolument rien changé au rythme de l’immigration brésilienne en Guyane. Tant s’en faut ! Et pour cause. La société brésilienne n’est toujours pas parvenue à tenir les promesses qu’autorisent un territoire immense, aux richesses variées, une population jeune et dynamique, une position culturelle exceptionnelle, au carrefour de trois sources d’inspiration, l’européenne, l’américaine et l’africaine. Ambassadeur de France dans les années 30, Paul Claudel, qui avait la vue perçante et la dent dure, a un jour laissé tomber : « Le Brésil, pays d’avenir…et qui le restera ». Comme en écho, De Gaulle a lâché un beau matin à Cayenne ce commentaire sans appel : « Ce pays n’est pas sérieux ». « Le géant du futur » a beau être la dixième puissance mondiale, son développement est loin de connaître le rythme impétueux qui fut jadis celui du Japon, et naguère celui de la Corée du Sud. Et il demeure, en 2006, le pays le plus inégalitaire de la planète.
Pour autant, ne tombons pas dans l’angélisme. L’inégalité sociale n’est pas, comme dirait mon ami Nestor Radjou, un obstacle rédhibitoire au décollage industriel. Le capitalisme est un moteur qui fonctionne à la différence de température entre le centre et la périphérie, conformément aux principes de la thermodynamique. Encore faut-il que l’ensemble des éléments soit constitué en système. Au Brésil, c’est bien là que le bât blesse. Pour s’en convaincre, il suffit de se promener du côté de Rio, où les plus riches vivent dans de splendides villas, entourées de barbelés parfois électrifiés et surmontés de miradors, et les plus pauvres s’entassent dans d’interminables fourmilières, qui vont de la maison en dur à la cabane en mou, en passant par tous les stades intermédiaires. On objectera - Et à raison ! - que de Montjoly à Matoury il y a aussi bien de la différence. Sans doute, mais à l’intérieur d’un réseau urbain et social continu, où l’histoire, à défaut du niveau de revenu, tient lieu de fédérateur. Cayenne est un espace défini, où les différents quartiers, les monuments publics, les institutions et les services composent un ensemble organique et cohérent, quand Bélem ressemble plutôt à une addition de molécules sans commencement ni fin. Pays-continent, le Brésil, à dire vrai, s'est construit à coups de projets pharaoniques : une capitale livrée clés en main, des routes transamazoniennes, des barrages gigantesques. Devenu puissance émergente, on le cite aujourd'hui aux côtés de la Chine, de l'Inde et de l'Afrique du Sud.
De ce Brésil, il y a peu de raisons d’en bouder la puissance régionale, mais aucune de ne pas en souhaiter l’unification. Peu de raisons donc de craindre les échanges avec lui, mais aucune raison, bien sûr et surtout, de s’étonner que nos opinions publiques manifestent de plus en plus leur inquiétude du peu de cas que Paris, dans ses relations avec Brasilia, fait des intérêts de la Guyane.
René Ladouceur
rene.ladouceur@wanadoo.fr
23 octobre 2006
Réagir à cet article
Du même auteur, sur blada.com :
Juillet 2006 : Le Foot-patriotisme
Juillet 2006 : Sous l'agression, la dignité
Mai 2006 : Adieu l'ami (un hommage à Jerry René-Corail)
Mars 2006 : Lettre ouverte à René Maran
Mars 2006 : Non à la régression
Janvier 2006 : Vive le débat
Juillet 2006 : Le Foot-patriotisme
Juillet 2006 : Sous l'agression, la dignité
Mai 2006 : Adieu l'ami (un hommage à Jerry René-Corail)
Mars 2006 : Lettre ouverte à René Maran
Mars 2006 : Non à la régression
Janvier 2006 : Vive le débat
Raccourcis


passer une petite annonce

passer une annonce de covoiturage


passer une annonce d’emploi

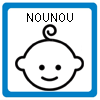





associations, postez vos actualités
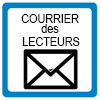
participez au courrier des lecteurs
La Guyane c’est ici
La qualité de l’Air avec
ATMO
Photothèque

Lancements 2022
Vol 259 Ariane 5