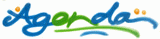Blada.com
Il est 11:07 en Guyane
vendredi 18 avril
vendredi 18 avril
le marron - chroniques atypiques de la guyane française
Chroniques
- Année 2021 (1)
- Année 2020 (2)
- Année 2019 (4)
- Année 2017 (1)
- Année 2014 (4)
- Année 2013 (9)
- Année 2012 (4)
- Année 2011 (6)
- Année 2010 (10)
- Année 2009 (12)
- Année 2008 (18)
- Année 2007 (12)
- Année 2006 (24)
- Année 2005 (18)
- Année 2004 (13)
- Année 2003 (6)
- Année 2002 (4)
- Année 2001 (6)
- Année 2000 (3)
 Lettre ouverte à René Maran
Lettre ouverte à René MaranPar René Ladouceur
L’histoire est trop belle pour que je vous en prive. La création, en Guyane, du Prix littéraire René Maran confirme l’existence dans votre pays d’une conjuration de lettrés fanatiques. Preuve que le temps a passé, mais, tout de même, avec cette lenteur, cette épaisseur, cette suspicion propres à la Guyane, où, comme arrêtés par la forêt vierge et de légendaires masquililis, les fuseaux horaires semblent ne pénétrer que par effraction.
Il reste que vous avez fait votre œuvre, puissante et furieuse, tissée de romans, nouvelles, essais, récits, poèmes sans vraiment gagner l’estime de vos compatriotes, qui sont de nature infidèles et négligent, par conformisme et plus encore par atavisme, ceux des leurs qui réussissent, y compris le Goncourt. Pourquoi la Guyane pense-t-elle à vous aujourd’hui ? Au Conseil général, organisateur du Prix aux côtés de l’association Jaguar, on n’est pas les derniers à remarquer que dans vos livres, écrits dans la langue claire d’un moraliste ayant hérité des Lumières, vous faites l’éloge de Voltaire, Condorcet, René Jadfard, Félix Eboué et de l’Afrique, où vous dénoncez les horreurs du racisme ordinaire et professez qu’on ne gagne jamais rien à mépriser l’autre.
En somme, vous avez élevé, avec le sourire, la morale à la hauteur d’une hygiène de l’esprit. D’ailleurs dans cette Afrique des années 20, parce que vous n’aspiriez à n’y être point remarqué, vous détonniez vraiment. Ce n’est pas que vous étiez plus âgé que vos collègues de l’Administration coloniale, plus consciencieux aussi, et presque trop souriant, c’est que vous sembliez venir d’un autre monde et ne faire que passer. Vous écriviez alors, pour tout dire, des textes délicats dans un français retenu, précautionneux. Vous serviez une langue qui ne vous abusait pas. Vos premiers admirateurs prenaient cela pour de la rigueur, avant de découvrir que c’était de la méfiance et du défi. Au reste, ces textes, à bien y regarder, ressemblent plutôt au journal intime d’un médecin de campagne, dont l’observation clinique de l’humiliation, le relevé méthodique de la misère, le spectacle révoltant de la discrimination raciale et, a contrario, l’immémoriale beauté des paysages traversés n’ont jamais laissé en paix. Le jeune écrivain rebelle était en réalité un esprit intranquille, d’une absolue solitude, sans cesse assailli par une émotivité contre laquelle il pensait être immunisé.
Si quelqu’un, dans ces années-là, s’était avisé de vous demander votre avis sur le « rôle positif » de la présence française en Afrique, vous lui auriez certainement ri au nez. A Paris, c’était pourtant la belle époque. Les dames du quartier de Montparnasse, votre quartier d’adoption, accourraient à vos cours de littérature, juchées sur des caisses à savon d’où elles tentaient de vous apercevoir, au risque de se fouler la cheville, en plus de se luxer le cerveau. Cette aptitude au leadership n’avait pas échappé à votre vieil ami Ernest Prévot qui, en 1947, alors qu’il était maire de Cayenne, vous a légué un fleuron de bibliothèque, la monumentale Histoire des Romains de Victor Duruy, dont les sept volumes ont longtemps enrichi vos réflexions sur les jeux politiques.
C’est d’ailleurs sous la plume de Victor Duruy que vous avez trouvé la formule adéquate pour résumer ce qu’il advînt de vos rapports avec Gaston Monnerville : « César avait le don des grands politiques qui savent faire servir jusqu’à leurs rivaux au succès de leurs desseins ». Gaston Monnerville n’était pas un César mais, ce don, lui aussi, il l’avait. Vous avez servi ses desseins jusqu’à le porter au pinacle du procès des Emeutiers de Cayenne alors que personne ne savait mieux que vous quels inconvénients ce choix pouvait représenter pour vos ambitions personnelles. Vous l’avez fait parce que la Guyane, c’était votre Rome à vous. Mais Monnerville était patricien, vous étiez plébéien, votre alliance forcément factice. De guerre lasse, vous vous êtes retiré sur votre Mont Tumuc-Humac, d’où vous descendiez en chroniqueur assidu de Temps nouveaux, le journal des amis de René Jadfard. Dans Temps nouveaux, vous faisiez alterner l’information et l’analyse, le portrait et la réflexion, l’apostrophe et l’éloge. Votre plume, vous vous en serviez comme d’une épée, pour frapper, tailler, pourfendre. Gaston Monnerville l’a appris à ses dépens. Dans Précisions utiles et vérités oubliées, vous lui contestez à ce point la paternité de l’acquittement des émeutiers de Cayenne que vous y apparaissez comme le hussard rouge de la république des lettres. Sabre au clair ! Félix Eboué, dit-on, rêvait de sensibiliser la Guyane avec des mots au singulier ; vous vous efforciez de le faire avec des phrases au vitriol.
On ne le répètera jamais assez : vous avez obtenu le Goncourt en publiant un pamphlet contre le colonialisme. On y a vu le panache d’un audacieux. On devrait plutôt y voir la réalisation du vrai écrivain, parvenu au point d’équilibre entre l’exigence littéraire et le volontarisme militant et pour lequel la langue est à la fois le lieu et le centre de l’effort dramatique. Ce goût pour l’impertinence, cette chronologie de la morale, ce calendrier du bon sens, cette hiérarchie des urgences ont été abandonnés au nom de confusions qui ont vite fait de condamner la littérature guyanaise, naguère juchée tout en haut de l’affiche, à jouer les faire-valoir.
Le Prix René Maran, le Prix qui porte votre nom, vient tout naturellement mettre un terme à cette trop longue et trop insupportable situation.
En somme, vous avez élevé, avec le sourire, la morale à la hauteur d’une hygiène de l’esprit. D’ailleurs dans cette Afrique des années 20, parce que vous n’aspiriez à n’y être point remarqué, vous détonniez vraiment. Ce n’est pas que vous étiez plus âgé que vos collègues de l’Administration coloniale, plus consciencieux aussi, et presque trop souriant, c’est que vous sembliez venir d’un autre monde et ne faire que passer. Vous écriviez alors, pour tout dire, des textes délicats dans un français retenu, précautionneux. Vous serviez une langue qui ne vous abusait pas. Vos premiers admirateurs prenaient cela pour de la rigueur, avant de découvrir que c’était de la méfiance et du défi. Au reste, ces textes, à bien y regarder, ressemblent plutôt au journal intime d’un médecin de campagne, dont l’observation clinique de l’humiliation, le relevé méthodique de la misère, le spectacle révoltant de la discrimination raciale et, a contrario, l’immémoriale beauté des paysages traversés n’ont jamais laissé en paix. Le jeune écrivain rebelle était en réalité un esprit intranquille, d’une absolue solitude, sans cesse assailli par une émotivité contre laquelle il pensait être immunisé.
Si quelqu’un, dans ces années-là, s’était avisé de vous demander votre avis sur le « rôle positif » de la présence française en Afrique, vous lui auriez certainement ri au nez. A Paris, c’était pourtant la belle époque. Les dames du quartier de Montparnasse, votre quartier d’adoption, accourraient à vos cours de littérature, juchées sur des caisses à savon d’où elles tentaient de vous apercevoir, au risque de se fouler la cheville, en plus de se luxer le cerveau. Cette aptitude au leadership n’avait pas échappé à votre vieil ami Ernest Prévot qui, en 1947, alors qu’il était maire de Cayenne, vous a légué un fleuron de bibliothèque, la monumentale Histoire des Romains de Victor Duruy, dont les sept volumes ont longtemps enrichi vos réflexions sur les jeux politiques.
C’est d’ailleurs sous la plume de Victor Duruy que vous avez trouvé la formule adéquate pour résumer ce qu’il advînt de vos rapports avec Gaston Monnerville : « César avait le don des grands politiques qui savent faire servir jusqu’à leurs rivaux au succès de leurs desseins ». Gaston Monnerville n’était pas un César mais, ce don, lui aussi, il l’avait. Vous avez servi ses desseins jusqu’à le porter au pinacle du procès des Emeutiers de Cayenne alors que personne ne savait mieux que vous quels inconvénients ce choix pouvait représenter pour vos ambitions personnelles. Vous l’avez fait parce que la Guyane, c’était votre Rome à vous. Mais Monnerville était patricien, vous étiez plébéien, votre alliance forcément factice. De guerre lasse, vous vous êtes retiré sur votre Mont Tumuc-Humac, d’où vous descendiez en chroniqueur assidu de Temps nouveaux, le journal des amis de René Jadfard. Dans Temps nouveaux, vous faisiez alterner l’information et l’analyse, le portrait et la réflexion, l’apostrophe et l’éloge. Votre plume, vous vous en serviez comme d’une épée, pour frapper, tailler, pourfendre. Gaston Monnerville l’a appris à ses dépens. Dans Précisions utiles et vérités oubliées, vous lui contestez à ce point la paternité de l’acquittement des émeutiers de Cayenne que vous y apparaissez comme le hussard rouge de la république des lettres. Sabre au clair ! Félix Eboué, dit-on, rêvait de sensibiliser la Guyane avec des mots au singulier ; vous vous efforciez de le faire avec des phrases au vitriol.
On ne le répètera jamais assez : vous avez obtenu le Goncourt en publiant un pamphlet contre le colonialisme. On y a vu le panache d’un audacieux. On devrait plutôt y voir la réalisation du vrai écrivain, parvenu au point d’équilibre entre l’exigence littéraire et le volontarisme militant et pour lequel la langue est à la fois le lieu et le centre de l’effort dramatique. Ce goût pour l’impertinence, cette chronologie de la morale, ce calendrier du bon sens, cette hiérarchie des urgences ont été abandonnés au nom de confusions qui ont vite fait de condamner la littérature guyanaise, naguère juchée tout en haut de l’affiche, à jouer les faire-valoir.
Le Prix René Maran, le Prix qui porte votre nom, vient tout naturellement mettre un terme à cette trop longue et trop insupportable situation.
René Ladouceur
rene.ladouceur@wanadoo.fr
Mars 2006
Réagir à cet article
Raccourcis


passer une petite annonce

passer une annonce de covoiturage


passer une annonce d’emploi

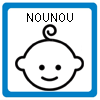





associations, postez vos actualités
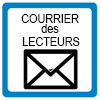
participez au courrier des lecteurs
La Guyane c’est ici
La qualité de l’Air avec
ATMO
Photothèque

Lancements 2022
Vol 259 Ariane 5