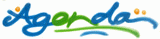Blada.com
samedi 19 avril
Chroniques
- Année 2021 (1)
- Année 2020 (2)
- Année 2019 (4)
- Année 2017 (1)
- Année 2014 (4)
- Année 2013 (9)
- Année 2012 (4)
- Année 2011 (6)
- Année 2010 (10)
- Année 2009 (12)
- Année 2008 (18)
- Année 2007 (12)
- Année 2006 (24)
- Année 2005 (18)
- Année 2004 (13)
- Année 2003 (6)
- Année 2002 (4)
- Année 2001 (6)
- Année 2000 (3)

par René Ladouceur
On ne saura jamais si René Maran aurait été séduit par le piké diouk mais dans Un homme pareil aux autres*, il consacre une large place au carnaval. Dans ce livre, Richard, l’ami du narrateur, est sans illusions. Il erre, la nuit, sur le boulevard Jubelin en pleurant l’époque où il se travestissait en femme éplorée, se régalait dans les bals Parés-masqués, ne manquait pas un défilé du Mardi gras. C’était l’époque où le carnaval avait son protocole, où la passion de danser faisait faire des folies, où il était jeune. Sur la plage, il explique à la plantureuse Sylviane Bendeau ce que fut, autrefois, la rage de briser les tabous et le plaisir d’être choisi par une cavalière. Peu après la Libération, on apprit que le Richard en question n’était autre qu’un cousin de René Maran. Architecte, contemporain et admirateur de Le Corbusier, Richard Maran adorait l’espace. Sa folie des grandeurs corrigeait sa phobie de la petitesse. C’est lui qui avait construit, à Cayenne, La nouvelle cité, sise alors à l’angle des rues Christophe Colomb et Rouget de l’Isle. Il séduisait un auvent comme une femme et travaillait la grammaire de ses plafonds ainsi qu’un concours de mazurka.
Dans Un homme pareil aux autres, René Maran apparaît bien comme un as de la flânerie, cet art en voie de disparition. Il faut dire que dans les années 20, c’était un genre littéraire de la plus belle eau. On ne remerciera jamais assez les organisateurs du Prix René Maran de s’obstiner à inviter le public à baguenauder entre les lignes. Mais René Maran en 2008, c’est d’abord, de mon point de vue, une navigation sur l’océan du langage, une protestation éloquente contre la décadence de l’écriture constatée aujourd’hui, une tentative désespérée pour ressaisir, sous nos latitudes, le français à l’agonie, du moins le français-guyanais, ce français si savoureux et truffé d’expressions locales que parlaient notamment les lettrés mananais et qui leur venait autant des instituteurs et des épigones d’Anne-Marie Javouhey que de leur mère et de leur père. En ce temps-là, il n'était de vraie culture sans la connaissance des maximes que transmettait, souvent en créole, la famille. Maran en a bien heureusement profité et c’est ce qui l’a aidé à comprendre le mystère de l’âme guyanaise. Ces maximes l’ont aidé mieux encore que **Jean Galmot, et davantage même que l’irremplaçable ***Alfred Parépou dont les observations sont beaucoup plus caustiques et définitives que ****René Jadfard ne devait en faire sur « Les pesanteurs de la société créole ».
C’est une erreur de croire que, plus elles déclinent et se courbent, plus les personnes âgées se penchent sur leur passé. Au contraire, c’est l’enfance qui les rattrape, grandit en elles et leur sourit. Sous l’écorce gercée, ridée, bat soudain un cœur gamin. On dirait des retrouvailles. René Maran a attendu d’avoir 67 ans pour que le saisisse, intacte et brûlante, l’émotion de ses jeunes souvenirs guyanais. Il les évoque dans un bref récit sans titre, avec cette faculté d'abandon, d'oubli, de perte de soi, qui est la trace du tacite contrat passé avec l'écrivain, quand celui-ci se tient au seuil des souterrains de son enfance. Dans ce récit lent, lourd, sinueux, puissant, chargé d’odeurs et de pérégrinations, l'auteur de Batouala** s'applique, d’une certaine manière, à répondre à la question que posent aujourd'hui les organisateurs du Prix René Maran. La Guyane qu'il y dessine n'est autre que celle qu’il voit dans le regard de son père et qu'il finit, de page en page, par idéaliser.
Par une étrange coïncidence, le Prix René Maran, pour sa troisième édition, a été lancé au moment même où l’Affaire Balaté, à Saint-Laurent, commençait à s’essouffler. Curieusement, chacun s’est efforcé de maintenir cette Affaire dans les limites du droit coutumier, comme si les habitants de Balaté n’étaient que des Amérindiens et que le conflit qui les oppose ne pouvait que concerner de très loin les autres Guyanais. René Maran a dû se retourner dans sa tombe. Rien ne l'indignait davantage que la différence de traitement entre les différentes composantes de la société guyanaise. « Nos ressemblances sont bien plus importantes que nos différences, tempêtait-il. En Guyane, il y a d'abord des Guyanais. Le fait qu’ils soient d'origine amérindienne, d'origine créole, d'origine bushinenguée n’est pas primordial puisque c'est ensemble qu'ils sont appelés à bâtir le pays ».
C'est que pour Maran, si tout est sorti du Que sais-je ? de Montaigne, tout va vite arriver au Qui suis-je ? de Rousseau. L'écrivain va rendre partout hommage à Jean-Jacques Rousseau, « fondateur des sciences de l'homme ». « J'ai à présent une violente aversion, écrit-il à Félix Eboué, pour les Etats qui dominent les autres ». On n'a sans doute jamais instruit contre le colonialisme le procès le plus définitivement implacable que ne le fait Maran en s'appuyant sur Montaigne et Rousseau.
Il reste que l'embarras avec lequel les médias, le mois dernier, ont évoqué le problème de Balaté est très symptomatique du malaise dans lequel s’enferre chaque jour davantage la Guyane. Voyez le développement des radios et bientôt des journaux communautaires. Chacun s’aventure de moins en moins en dehors de son milieu, son cocon protecteur. Le phénomène n'épargne pas les intellectuels qui, eux aussi, chassent en meute. Sale période pour les fraternités, même dînatoires. La glue progresse sans crier gare pour laisser place à une société alvéolaire, encoquillée, à confort intellectuel maximal et coexistence physique minimale. C’est, je crois, le moment de lancer une campagne de banquets républicains, et d'installer autour d’une même table des Amérindiens, des Créoles, des Bushinengués, des Métros. A ces banquets, on mettrait un instant entre parenthèses son sexe, sa généalogie et sa couleur de peau. Pas pour les nier, mais pour les dépasser. Pourquoi est-ce si grave l’idéologie communautaire ? Parce que son ciment, c’est précisément le victimisme. Or des communautés de victimes ne constituent jamais une vraie communauté. Et pour cause. A l’intérieur de cette communauté chacun se sent plus victime que son voisin.
On ne saurait mieux illustrer l'étrange défaite de l’esprit guyanais, du « génie guyanais », disait même René Maran. Cet esprit, pendant longtemps, a oublié toute rigueur classique, tout élan romantique, toute énergie moderne, pour s’égarer dans la contestation permanente, avant de s'amollir dans la résignation. Le Prix René Maran arrive à point nommé. Par les valeurs qu’il exige et les remises en cause qu’il implique, il peut, bien plus que le Prix Carbet, obliger la Guyane à renouer avec l’excellence et le sentiment de fierté.
René Ladouceur
rene.ladouceur@wanadoo.fr
Janvier 2008
*L’édition de cette géniale autobiographie est, hélas !, épuisée depuis longtemps. Parue en 1947, elle a été rééditée en 1962, chez Albin Michel
**Lisez ou relisez séance tenante Un mort vivait parmi nous, réédité, en 1995, au Serpent à plumes
***Lisez ou relisez séance tenante Atipa, réédité, en 1980, sous l’égide de l’UNESCO, aux Editions caraibéennes. Paru en 1885, il est le premier roman en langue créole
****Lisez ou relisez séance tenante Nuits de cachiri, réédité, en 1988, aux Editions caraibéennes
*****Le titre du livre grâce auquel René Maran obtient, en 1921, le Goncourt. 208 pages. ISBN13 : 978-2-210-75450-8, chez Albin Michel
Du même auteur, sur blada.com :
Juillet 2007 : Un si doux ennui
Janvier 2007 : Entre histoire et mémoire
Octobre 2006 : Notre grand voisin
Juillet 2006 : Le Foot-patriotisme
Juillet 2006 : Sous l'agression, la dignité
Mai 2006 : Adieu l'ami (un hommage à Jerry René-Corail)
Mars 2006 : Lettre ouverte à René Maran
Mars 2006 : Non à la régression
Janvier 2006 : Vive le débat
Raccourcis


passer une petite annonce

passer une annonce de covoiturage


passer une annonce d’emploi

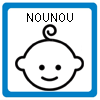





associations, postez vos actualités
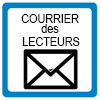
participez au courrier des lecteurs
La Guyane c’est ici
La qualité de l’Air avec
ATMO
Photothèque

Lancements 2022
Vol 259 Ariane 5