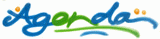Blada.com
Il est 01:29 en Guyane
dimanche 23 février
dimanche 23 février
le marron - chroniques atypiques de la guyane française
Chroniques
- Année 2021 (1)
- Année 2020 (2)
- Année 2019 (4)
- Année 2017 (1)
- Année 2014 (4)
- Année 2013 (9)
- Année 2012 (4)
- Année 2011 (6)
- Année 2010 (10)
- Année 2009 (12)
- Année 2008 (18)
- Année 2007 (12)
- Année 2006 (24)
- Année 2005 (18)
- Année 2004 (13)
- Année 2003 (6)
- Année 2002 (4)
- Année 2001 (6)
- Année 2000 (3)
 Cet article a été publié dans son intégralité dans la revue
Cet article a été publié dans son intégralité dans la revue« Drôle d’époque », numéro 17, automne 2005.
Ethique et esthétique du marronnage
par Dénètem Touam Bona
4ème partie
par Dénètem Touam Bona
4ème partie
Au-delà du cercle…
C’est au Surinam et sur les rives françaises du Maroni (Guyane) que sont apparues les cultures marronnes les plus complexes et les plus durables, celles des N’djuka, Saramaka, Aluku, Matawaï, et autres groupes Businenge.
Ailleurs les communautés marronnes ont été, à quelques exceptions près (Garifunas et Congos d’Amérique centrale, Maroons de Jamaïque), détruites ou assimilées. Les premières manifestations d’un art (plastique)1 spécifiquement marron datent du début du 19ème siècle : ce sont des peignes, des pagaies, des bancs, des objets quotidiens. Il s’agit avant tout d’un art du relief ; un relief qui se dégage du bois marqué, évidé, taillé, sculpté. Les Businenge désignent leurs productions artistiques et artisanales par le terme « tembe ». Altération de l'anglais « timber » qui désigne le bois de construction (poutres, planches, étais, etc.), « tembe » renvoie d’emblée à un lexique technique et non artistique. Si la notion de construction occupe une place centrale dans le tembe, c’est parce que la genèse de cet art ne se comprend qu'à partir de l'outil. Pour reprendre une expression de Patrick Lacaisse2, « l’outil est fondateur du tembe ». Aujourd'hui encore, chez les Businenge, la composition à main libre n’existe pas. Parce qu’il y a l’outil – le compas, la hache, la pointe sèche, la scie, la règle – il y a la sculpture sur bois. L’art marron n’a donc rien de « primitif » ou de « premier » (pour utiliser un euphémisme…), il s’inscrit d’emblée dans la modernité occidentale dont il récupère, sans état d’âme, en fonction de ses propres fins, les dernières réalisations technologiques (exemples : incorporation du moteur hors-bord dans les pirogues, usage de la tronçonneuse dans les sculptures, recyclage des textiles modernes dans l’art du patchwork). En cela, les Marrons se distinguent fortement de leurs voisins Amérindiens dont l’attachement à des traditions ancestrales (comme l’usage d’outils en pierre) a longtemps freiné la créativité.
Mais comment l'outil occidental – un instrument d’esclavage, d'aliénation – est-t-il devenu dans les mains des marrons un instrument de création, de reconstruction de soi ? Au milieu du 18ème siècle, face à la menace d’un embrasement général du Surinam, les Hollandais furent contraints de ratifier des traités de paix avec les « bush negroes ». Ces accords prévoyaient, en échange de l'arrêt des hostilités, l'envoi d'un tribut annuel aux rebelles sous forme d'outils, d'armes et de biens divers ; ces derniers étant censés ramenés aux colons hollandais tout nouvel esclave fugitif. Le tembe naît précisément de l'appropriation créatrice par les marrons des outils du colon (nombre d’entre eux, durant leur période d’esclavage, avaient acquis la maîtrise de techniques occidentales). Il naît d'un détournement de sens et de fonction. Le tembe, c’est la réinvention, dans le creux du bois, du corps et de la famille nègres démantelés par l’esclavage. Une réinvention qui se lit dans le lexique utilisé par les marrons pour identifier les éléments de leurs sculptures. C’est ainsi que les « yeux » désignent les petits replis des entrelacs, le « cou » les parties intermédiaires qui font communiquer entre eux les rubans sculptés (reliant la tête au reste du corps, le cou est « reliure »), le « nombril » le foyer central de la composition, les « mains » les étais qui supportent la composition, la « maman » la figure matrice, les « enfants » les figures secondaires. Ici, la référence au corps ne doit pas être prise dans un sens symbolique ou métaphorique. Les tembe ne représentent pas des corps, ils fonctionnent comme des corps : des corps fugitifs... Le recours au « bois » propre au tembe, dans l’ordre esthétique et technique, renvoie directement au « recours aux forêts » propre au marronnage en général, dans l’ordre de l'action.
La fugue, en tant que principe « rythmique » de cryptage et de variation, s’inscrit directement dans la structure du tembe. Chaque oeuvre se construit à partir d’un système de rubans : des figures complexes, entrelacées les unes aux autres, inscrites dans le bois comme autant de lignes de fuites et de fausses pistes. Les rubans tournent, plongent, resurgissent, par-dessus, par-dessous les uns les autres, offrant ainsi au regard l’épreuve du vertige. Les tembe se lisent en suivant du bout du doigt les itinéraires inscrits dans le creux d’un plat à vanner, sur la tête d’une pagaie ou sur l’assise d’un banc. Ces parcours s'empruntent comme on emprunte un layon en forêt. La virtuosité de l’artiste se mesure à sa capacité à brouiller les pistes. D’où une composition de l’œuvre par moitié ou par quart, de façon à ce que les principes qui l’ont régis demeurent insaisissables. Lire un tembe, c’est s’engager dans un labyrinthe à la poursuite d’un fugueur fictif. Dans la sculpture marronne, l'usage du compas étant quasi systématique, la plupart des figures et motifs s'inscrivent dans des cercles. Or le cercle circonscrit. Tout l’effort de l’artiste – qui s’impose sciemment cette contrainte – sera justement d’en sortir. Le tembe, c'est l'évasion du cercle : la cavale dans les bois matérialisée dans le relief du « bois » sculpté. L’esthétique marronne est une esthétique de la disparition.
Dénètem TOUAM BONA
den2am@yahoo.fr
Mars 2006
1. Pour des raisons de concision, nous ne nous intéresserons ici qu’à la sculpture des Businenge. Leur culture comprend évidemment bien d’autres formes d’art : danses, musiques, arts du corps (scarifications, coiffures), etc.
2. Mes analyses sur le Tembe doivent beaucoup aux longs entretiens que cet artiste m’a accordés. J’en profite pour rendre hommage au travail de mise en valeur des arts marrons et amérindiens effectué par l’association « Chercheurs d’art » (Mana).
Du même auteur, en ligne :
Ethétique et esthétique du marronnage :
1ère partie : L'espace d'une fugue...
2e partie : La « communauté » : une utopie créatrice
3e partie : Zones franches
Africultures : Dressage et sélection du bétail humain
Blada : “ Ecrire ” Haïti… Frankétienne, Lyonel Trouillot, Gary Victor
Interdits.net : Dans les interstices de la ville
Interdits.net : A l’écoute des guérisseurs
Interdits.net : Ethnopsychiatrie
Interdits.net : Profession : Grigithérapeuthe
Interdits.net : Ouvrier : un mot en friche
Interdits.net : La révolte d’Attica
Interdits.net : Le cas Pinochet
Interdits.net : Ecrits et images du Brésil
Interdits.net : Dani Kouyaté en Guyane : Eloge de la folie
Interdits.net : La croisière immobile des détenus de Loos
Interdits.net : Ecrits et images du Brésil
Interdits.net : Dani Kouyaté en Guyane : Eloge de la folie
Interdits.net : La croisière immobile des détenus de Loo
2. Mes analyses sur le Tembe doivent beaucoup aux longs entretiens que cet artiste m’a accordés. J’en profite pour rendre hommage au travail de mise en valeur des arts marrons et amérindiens effectué par l’association « Chercheurs d’art » (Mana).
Du même auteur, en ligne :
Ethétique et esthétique du marronnage :
1ère partie : L'espace d'une fugue...
2e partie : La « communauté » : une utopie créatrice
3e partie : Zones franches
Africultures : Dressage et sélection du bétail humain
Blada : “ Ecrire ” Haïti… Frankétienne, Lyonel Trouillot, Gary Victor
Interdits.net : Dans les interstices de la ville
Interdits.net : A l’écoute des guérisseurs
Interdits.net : Ethnopsychiatrie
Interdits.net : Profession : Grigithérapeuthe
Interdits.net : Ouvrier : un mot en friche
Interdits.net : La révolte d’Attica
Interdits.net : Le cas Pinochet
Interdits.net : Ecrits et images du Brésil
Interdits.net : Dani Kouyaté en Guyane : Eloge de la folie
Interdits.net : La croisière immobile des détenus de Loos
Interdits.net : Ecrits et images du Brésil
Interdits.net : Dani Kouyaté en Guyane : Eloge de la folie
Interdits.net : La croisière immobile des détenus de Loo
Raccourcis


passer une petite annonce

passer une annonce de covoiturage


passer une annonce d’emploi

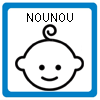





associations, postez vos actualités
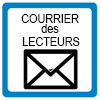
participez au courrier des lecteurs
La Guyane c’est ici
La qualité de l’Air avec
ATMO
Photothèque

Lancements 2022
Vol 259 Ariane 5