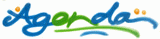Blada.com
Il est 16:46 en Guyane
samedi 22 février
samedi 22 février
le marron - chroniques atypiques de la guyane française
Chroniques
- Année 2021 (1)
- Année 2020 (2)
- Année 2019 (4)
- Année 2017 (1)
- Année 2014 (4)
- Année 2013 (9)
- Année 2012 (4)
- Année 2011 (6)
- Année 2010 (10)
- Année 2009 (12)
- Année 2008 (18)
- Année 2007 (12)
- Année 2006 (24)
- Année 2005 (18)
- Année 2004 (13)
- Année 2003 (6)
- Année 2002 (4)
- Année 2001 (6)
- Année 2000 (3)
 Boycotter le Brésil ?
Boycotter le Brésil ?par Gérard Police
Docteur en études brésiliennes, maître de conférences à l’Université des Antilles et de la Guyane (IES de la Guyane), Gérard Police est Guyanais depuis 1978, arpenteur du Brésil depuis cette date, en avion, en bus, en moto, à pied. Il y a connu les gens de tous les milieux, à l'exception des gangsters et trafiquants de drogue, précise-t-il. En tant que chercheur, il a travaillé en particulier sur la construction de l'identité afro-brésilienne et publié deux livres dans cette problématique : « La fête noire au Brésil - l'Afro-Brésilien et ses doubles », l'Harmattan, 1996, et « Quilombos dos Palmares - lectures sur un marronnage brésilien », Ibis Rouge 2003. Parmi d'autres sujets, il s'est penché dernièrement sur le fantasme de « l'invasion de la Guyane par le Brésil » (ouvrage collectif à paraître).

Année après année, jour après jour, suivre de près l’actualité du Brésil constitue une épreuve qui me conduit épisodiquement à me demander s’il faut continuer. Mais la réponse est donnée avant la question : un brésilianiste n’a pas le choix.
Une certaine dose d’abnégation ou de masochisme est nécessaire pour supporter les images de notre miséra-ble monde. C’est le lot inévitable de l’information : n’intéressent que les vilenies et les horreurs. Certains pays s’y illustrent particulièrement. Dans la partie du monde nous concernant, il n’y pas loin à aller chercher. Le Brésil détient des records.
L’étonnant est la tolérance bienveillante avec laquelle les dérèglements de notre voisin sont reçus, presque excusés, quasiment pardonnés. La grande réussite du Brésil sur le plan international n’est pas le football ni les biocarburants, mais sa prodigieuse capacité « carnavalesque ». Entendons-nous bien : samba et costumes ne nous intéressent pas ici. Il s’agit, de façon autrement moins réjouissante, de sa faculté d’occulter sous une couche de fard criard, sous un maquillage clinquant et une gaieté exhibitionniste, une face sinistre ; de réussir à faire pencher la balance de la cote de popularité du bon côté grâce à une prodigieuse manipulation symbolique dans laquelle la boue devient de l’or. Symbolique ? Même pas.
Un détournement de sens propagandiste et un exotisme naïf et complice ont réussi à installer le mythe d’une société « cordiale » alors que la réalité profonde est gangrenée d’hypocrisie, de mépris de l’autre, de surexploitation, d’esclavage, de violence, d’inhumanité.
Le discours sur le Brésil est toujours « déréalisé » ; le langage qui en rend compte est à l’avance connoté par des stéréotypes tiers-mondistes, tropicalistes, sexualisés. Il n’est pas du tout impossible de le corriger, de le « réaliser », de le « décarnavaliser ». Sauf que l’exercice heurte le régime de croyances à tolérance limitée qui nous sert de référence. A partir d’ici, cessez la lecture si vous craignez d’être dérangé dans votre brésilophilie inconditionnelle. Je veux être excessif à rebours, carnavalesque dans le sinistre. Mes excuses aux honnêtes citoyens qui souffrent dans leur amour non rendu du pays.
Le Brésil est en guerre. Non pas métaphoriquement, mais de façon concrète et sanglante. Parmi les pays non officiellement en guerre (civile ou extérieure), les 55 000 morts annuels par assassinat (il n’y a pas d’erreur : cinquante-cinq mille assassinats en 2005, chiffres officiels) le placent dans le peloton de tête mondial. Plus qu’en Irak, baromètre actuel de l’horreur. A ce rythme la population de la Guyane est exterminée en 3 ans et demi.
Mais l’accumulation des chiffres et des données ne fait plus sens : la barbarie se dématérialise, la bestialité se dissout en arithmétique. Pour le dire crûment, règne au Brésil, depuis cinq siècles, un système criminel, mafieux, avec pour objectif premier l’organisation et la perpétuation de l’exploitation des personnes et le pillage des richesses et ressources au profit de kleptocrates cyniques traînant dans leur sillage les hordes d’un lumpen-proletariat déshumanisé.
En essayant de faire court, la liste commence par la classe politique et les dirigeants, et se poursuit sans exhaustivité avec les propriétaires terriens et saccageurs d’Amazonie, les juges et autres magistrats, les forces de l’ordre, les trafiquants et tueurs à gage, et la cohorte de tous les criminels qui, à des degrés divers mais toujours révoltants, dominent la société brésilienne. Avec pour conséquences le délabrement endémique des systèmes de santé, d’éducation, de protection sociale, de justice, de répartition des richesses. Avec pour résultat ultime le déni permanent de la dignité humaine.
La question n’est pas de disséquer les entrailles nauséabondes de contingences socio-historiques maintes fois ressassées. Il n’y a pas de fatalisme historique ou d’odieuse mondialisation à invoquer quand la délinquance est un mode de vie. Les explications ne sont pas des excuses.
Méprisés par la population mais paradoxalement adoubés par des électeurs qui rêvent d’en être, corrompus par nature, les membres de la classe politique et de l’administration, de l’échelon le plus modeste jusqu’au sommet de l’État, carnavalisent leurs dévoiements sur le mode populiste pour transformer l’inacceptable en règle légitimée.
Mais cela semble bien peu, même si on ne change pas d’univers, à côté de la sauvagerie quotidienne. Les faits divers les plus atroces parviennent encore à révolter une société qui en a pourtant vu d’autres. Une famille brûlée vive dans sa voiture, un enfant traîné et déchiqueté sur des kilomètres, des altruistes français massacrés au couteau ; et la routine des crânes éclatés à bout portant, des cadavres ramassés tous les matins dans les banlieues sordides, des balles perdues et meurtrières, des zones de non droit où même l’armée n’entre pas sans appréhension, des sadiques de moins de 18 ans à immunité garantie.
Car le pendant hallucinant de la criminalité est l’impunité. Au Brésil, le crime paie. Le crime rapporte. Le crime est un métier à moindres risques. La grande majorité des délinquants ne sont même pas inquiétés. Les politiciens voyous sont absous par leurs coreligionnaires voyous. Les patrons voyous soudoient des magistrats voyous. Les petits voyous payent les policiers voyous. Les voyous emprisonnés dirigent en sécurité leurs activités criminelles depuis leur cellule, par téléphone.
Leçon d’humanité pour des sociétés aussi « répressives » que la nôtre avec son régime de prison à perpétuité — disent certains — le Brésil offre une peine maximum de trente ans, et un attirail d’indulgences aux criminels qui permet d’évaluer le prix de la vie humaine : entre rien et une demi-douzaine d’années de réclusion. Sauf rarissime exception, l’assassin commun est assuré de passer la porte de la prison dans le bon sens, de son point de vue, assez tôt pour se refaire plusieurs vies. Dans le cas d’un mineur, il est relâché dans la nature à son dix-huitième anniversaire.
Ce n’est pas notre propos ici de débattre de la question des peines. Il s’agit de comprendre comment la disproportion grossière entre l’énormité de la criminalité et l’insignifiance de la punition génère une irresponsabilité fataliste dans laquelle le droit, le respect du droit et l’application du droit sont des principes fumeux échappant à tout absolu, au profit d’une relativité qui se constitue en réplique, en commémoration indécente du crime initial. Il n’est pas nécessaire de consulter Kant pour s’en convaincre. La presse brésilienne, pour qui veut bien la lire, et même la télévision, suffisent. D’ailleurs le présent article en est une synthèse, et une infime pièce supplémentaire dans l’immense recueil désespéré des dénonciations, protestations et lamentations de nos malheureux voisins.
Puisqu’il n’y a rien à faire, et que les Brésiliens eux-mêmes se résignent, on pourrait s’arrêter là. Mais on va continuer et boire jusqu’à la lie le calice du politiquement incorrect, par solidarité pour une population écoeurée et épuisée à survivre.
Faut-il envisager de boycotter le Brésil ?
Non pas. Ne pas l’ignorer, ne pas l’oublier, ne pas le reléguer au fond de nos indifférences ; ce serait trop facile. Au contraire s’obliger à s’y intéresser encore plus, plus profondément, plus inquisitorialement. Pénétrer profondément dans les rouages de sa machine à fantasmes, à illusions, à iniquités.
Et désigner à l’opprobre international ceux qui l’ont en charge, demander des comptes à tous ceux qui sont impliqués, acteurs connivents de l’infamie. Il est de bon ton, en politique extérieure, de faire savoir aux pays jugés violateurs des droits de l’homme qu’on réprouve leurs mauvaises manières. Le Brésil viole quotidiennement les droits de l’homme : droit à la vie, à la sécurité, au respect, aux conditions de vie décentes, à l’éducation, à la santé, à l’éthique ; droit à la dignité ; droit au droit… Le non droit est devenu la valeur identitaire brésilienne de réfé-rence. Le Brésil est une « obscénité sociale » (Clóvis Rossi, Folha de São Paulo - 3 mars 07).
Disons notre colère, notre révolte. Dire, car les mots ont du pouvoir.
Messieurs (Mesdames ?) les gouvernants brésiliens, dirigeants, responsables, élus, mandatés, vous tous sans exception, de tout bord, tout parti, toute obédience, de haut en bas et de bas en haut ; et vous aussi, miséreux complices, pauvres heureux de lécher les bottines des riches et des populistes, démissionnaires de citoyenneté et de dignité, délinquants du quotidien et du banal ; riches et pauvres, puissants et faibles. Nous vous avons jugés et condamnés.
Vous êtes déclarés coupables de crimes contre l’humanité.
Une certaine dose d’abnégation ou de masochisme est nécessaire pour supporter les images de notre miséra-ble monde. C’est le lot inévitable de l’information : n’intéressent que les vilenies et les horreurs. Certains pays s’y illustrent particulièrement. Dans la partie du monde nous concernant, il n’y pas loin à aller chercher. Le Brésil détient des records.
L’étonnant est la tolérance bienveillante avec laquelle les dérèglements de notre voisin sont reçus, presque excusés, quasiment pardonnés. La grande réussite du Brésil sur le plan international n’est pas le football ni les biocarburants, mais sa prodigieuse capacité « carnavalesque ». Entendons-nous bien : samba et costumes ne nous intéressent pas ici. Il s’agit, de façon autrement moins réjouissante, de sa faculté d’occulter sous une couche de fard criard, sous un maquillage clinquant et une gaieté exhibitionniste, une face sinistre ; de réussir à faire pencher la balance de la cote de popularité du bon côté grâce à une prodigieuse manipulation symbolique dans laquelle la boue devient de l’or. Symbolique ? Même pas.
Un détournement de sens propagandiste et un exotisme naïf et complice ont réussi à installer le mythe d’une société « cordiale » alors que la réalité profonde est gangrenée d’hypocrisie, de mépris de l’autre, de surexploitation, d’esclavage, de violence, d’inhumanité.
Le discours sur le Brésil est toujours « déréalisé » ; le langage qui en rend compte est à l’avance connoté par des stéréotypes tiers-mondistes, tropicalistes, sexualisés. Il n’est pas du tout impossible de le corriger, de le « réaliser », de le « décarnavaliser ». Sauf que l’exercice heurte le régime de croyances à tolérance limitée qui nous sert de référence. A partir d’ici, cessez la lecture si vous craignez d’être dérangé dans votre brésilophilie inconditionnelle. Je veux être excessif à rebours, carnavalesque dans le sinistre. Mes excuses aux honnêtes citoyens qui souffrent dans leur amour non rendu du pays.
Le Brésil est en guerre. Non pas métaphoriquement, mais de façon concrète et sanglante. Parmi les pays non officiellement en guerre (civile ou extérieure), les 55 000 morts annuels par assassinat (il n’y a pas d’erreur : cinquante-cinq mille assassinats en 2005, chiffres officiels) le placent dans le peloton de tête mondial. Plus qu’en Irak, baromètre actuel de l’horreur. A ce rythme la population de la Guyane est exterminée en 3 ans et demi.
Mais l’accumulation des chiffres et des données ne fait plus sens : la barbarie se dématérialise, la bestialité se dissout en arithmétique. Pour le dire crûment, règne au Brésil, depuis cinq siècles, un système criminel, mafieux, avec pour objectif premier l’organisation et la perpétuation de l’exploitation des personnes et le pillage des richesses et ressources au profit de kleptocrates cyniques traînant dans leur sillage les hordes d’un lumpen-proletariat déshumanisé.
En essayant de faire court, la liste commence par la classe politique et les dirigeants, et se poursuit sans exhaustivité avec les propriétaires terriens et saccageurs d’Amazonie, les juges et autres magistrats, les forces de l’ordre, les trafiquants et tueurs à gage, et la cohorte de tous les criminels qui, à des degrés divers mais toujours révoltants, dominent la société brésilienne. Avec pour conséquences le délabrement endémique des systèmes de santé, d’éducation, de protection sociale, de justice, de répartition des richesses. Avec pour résultat ultime le déni permanent de la dignité humaine.
La question n’est pas de disséquer les entrailles nauséabondes de contingences socio-historiques maintes fois ressassées. Il n’y a pas de fatalisme historique ou d’odieuse mondialisation à invoquer quand la délinquance est un mode de vie. Les explications ne sont pas des excuses.
Méprisés par la population mais paradoxalement adoubés par des électeurs qui rêvent d’en être, corrompus par nature, les membres de la classe politique et de l’administration, de l’échelon le plus modeste jusqu’au sommet de l’État, carnavalisent leurs dévoiements sur le mode populiste pour transformer l’inacceptable en règle légitimée.
Mais cela semble bien peu, même si on ne change pas d’univers, à côté de la sauvagerie quotidienne. Les faits divers les plus atroces parviennent encore à révolter une société qui en a pourtant vu d’autres. Une famille brûlée vive dans sa voiture, un enfant traîné et déchiqueté sur des kilomètres, des altruistes français massacrés au couteau ; et la routine des crânes éclatés à bout portant, des cadavres ramassés tous les matins dans les banlieues sordides, des balles perdues et meurtrières, des zones de non droit où même l’armée n’entre pas sans appréhension, des sadiques de moins de 18 ans à immunité garantie.
Car le pendant hallucinant de la criminalité est l’impunité. Au Brésil, le crime paie. Le crime rapporte. Le crime est un métier à moindres risques. La grande majorité des délinquants ne sont même pas inquiétés. Les politiciens voyous sont absous par leurs coreligionnaires voyous. Les patrons voyous soudoient des magistrats voyous. Les petits voyous payent les policiers voyous. Les voyous emprisonnés dirigent en sécurité leurs activités criminelles depuis leur cellule, par téléphone.
Leçon d’humanité pour des sociétés aussi « répressives » que la nôtre avec son régime de prison à perpétuité — disent certains — le Brésil offre une peine maximum de trente ans, et un attirail d’indulgences aux criminels qui permet d’évaluer le prix de la vie humaine : entre rien et une demi-douzaine d’années de réclusion. Sauf rarissime exception, l’assassin commun est assuré de passer la porte de la prison dans le bon sens, de son point de vue, assez tôt pour se refaire plusieurs vies. Dans le cas d’un mineur, il est relâché dans la nature à son dix-huitième anniversaire.
Ce n’est pas notre propos ici de débattre de la question des peines. Il s’agit de comprendre comment la disproportion grossière entre l’énormité de la criminalité et l’insignifiance de la punition génère une irresponsabilité fataliste dans laquelle le droit, le respect du droit et l’application du droit sont des principes fumeux échappant à tout absolu, au profit d’une relativité qui se constitue en réplique, en commémoration indécente du crime initial. Il n’est pas nécessaire de consulter Kant pour s’en convaincre. La presse brésilienne, pour qui veut bien la lire, et même la télévision, suffisent. D’ailleurs le présent article en est une synthèse, et une infime pièce supplémentaire dans l’immense recueil désespéré des dénonciations, protestations et lamentations de nos malheureux voisins.
Puisqu’il n’y a rien à faire, et que les Brésiliens eux-mêmes se résignent, on pourrait s’arrêter là. Mais on va continuer et boire jusqu’à la lie le calice du politiquement incorrect, par solidarité pour une population écoeurée et épuisée à survivre.
Faut-il envisager de boycotter le Brésil ?
Non pas. Ne pas l’ignorer, ne pas l’oublier, ne pas le reléguer au fond de nos indifférences ; ce serait trop facile. Au contraire s’obliger à s’y intéresser encore plus, plus profondément, plus inquisitorialement. Pénétrer profondément dans les rouages de sa machine à fantasmes, à illusions, à iniquités.
Et désigner à l’opprobre international ceux qui l’ont en charge, demander des comptes à tous ceux qui sont impliqués, acteurs connivents de l’infamie. Il est de bon ton, en politique extérieure, de faire savoir aux pays jugés violateurs des droits de l’homme qu’on réprouve leurs mauvaises manières. Le Brésil viole quotidiennement les droits de l’homme : droit à la vie, à la sécurité, au respect, aux conditions de vie décentes, à l’éducation, à la santé, à l’éthique ; droit à la dignité ; droit au droit… Le non droit est devenu la valeur identitaire brésilienne de réfé-rence. Le Brésil est une « obscénité sociale » (Clóvis Rossi, Folha de São Paulo - 3 mars 07).
Disons notre colère, notre révolte. Dire, car les mots ont du pouvoir.
Messieurs (Mesdames ?) les gouvernants brésiliens, dirigeants, responsables, élus, mandatés, vous tous sans exception, de tout bord, tout parti, toute obédience, de haut en bas et de bas en haut ; et vous aussi, miséreux complices, pauvres heureux de lécher les bottines des riches et des populistes, démissionnaires de citoyenneté et de dignité, délinquants du quotidien et du banal ; riches et pauvres, puissants et faibles. Nous vous avons jugés et condamnés.
Vous êtes déclarés coupables de crimes contre l’humanité.
Gérard Police
gerard.police@blada.com
Mars 2007
Raccourcis


passer une petite annonce

passer une annonce de covoiturage


passer une annonce d’emploi

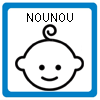





associations, postez vos actualités
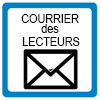
participez au courrier des lecteurs
La Guyane c’est ici
La qualité de l’Air avec
ATMO
Photothèque

Lancements 2022
Vol 259 Ariane 5